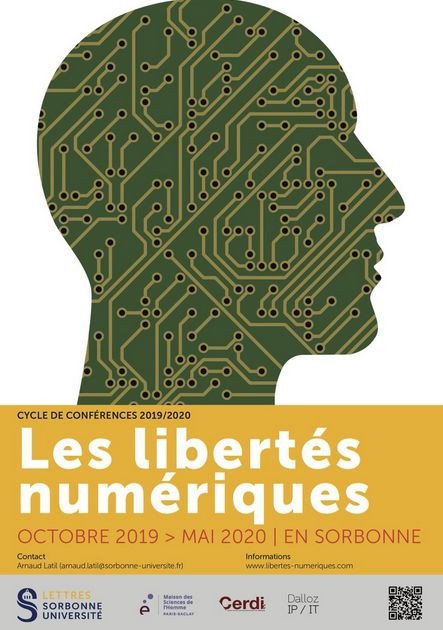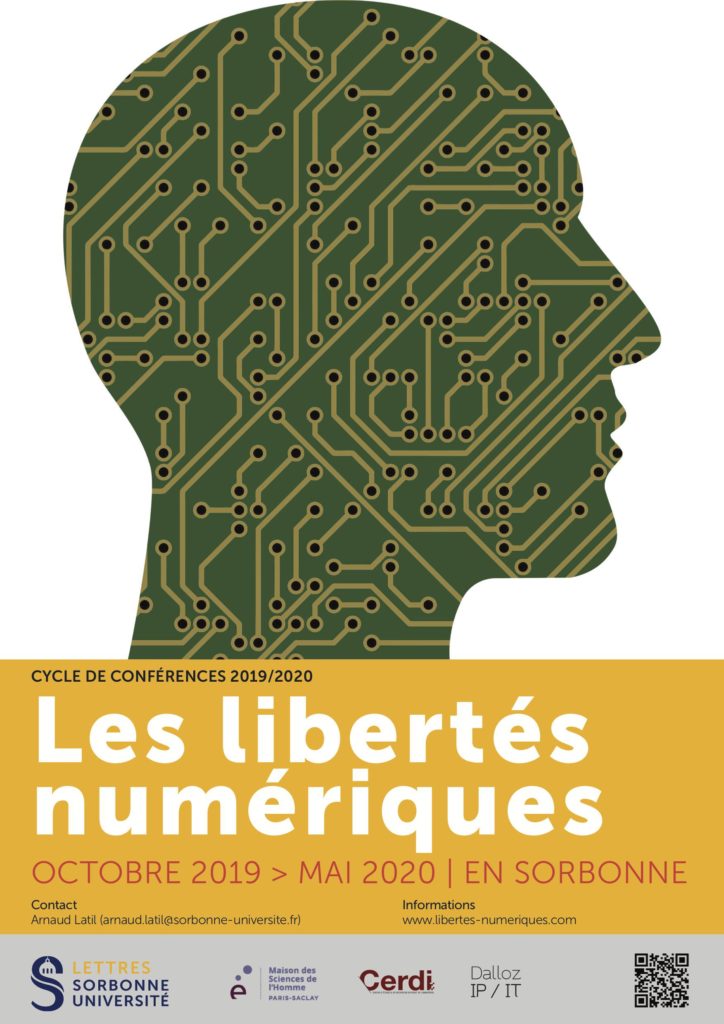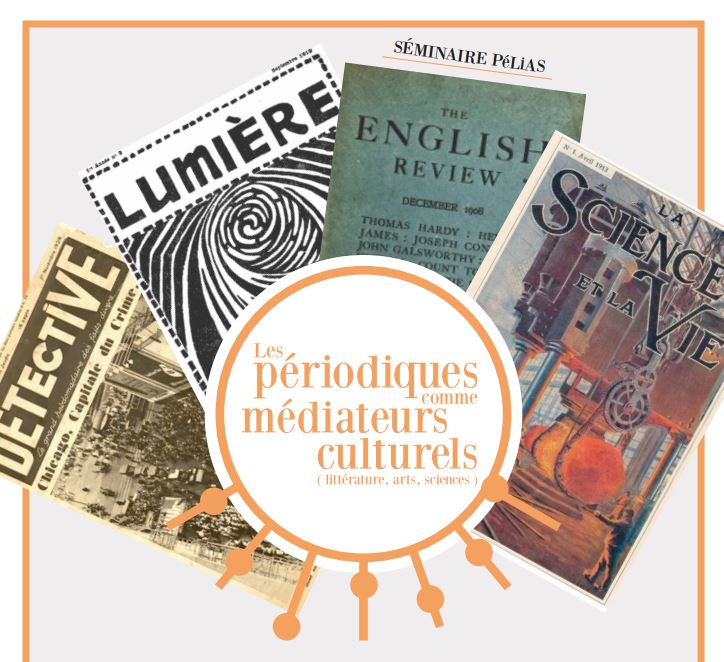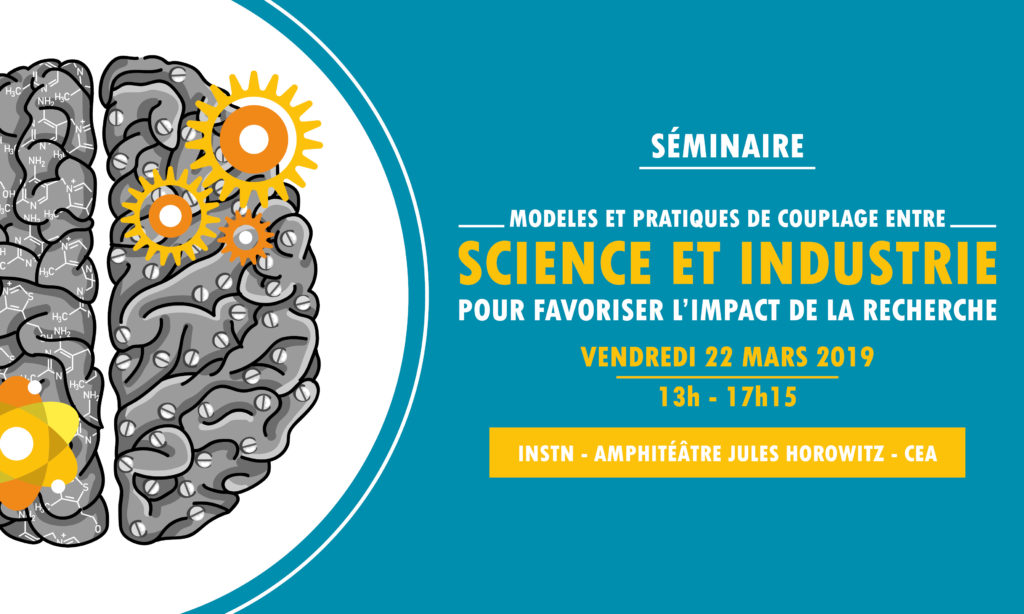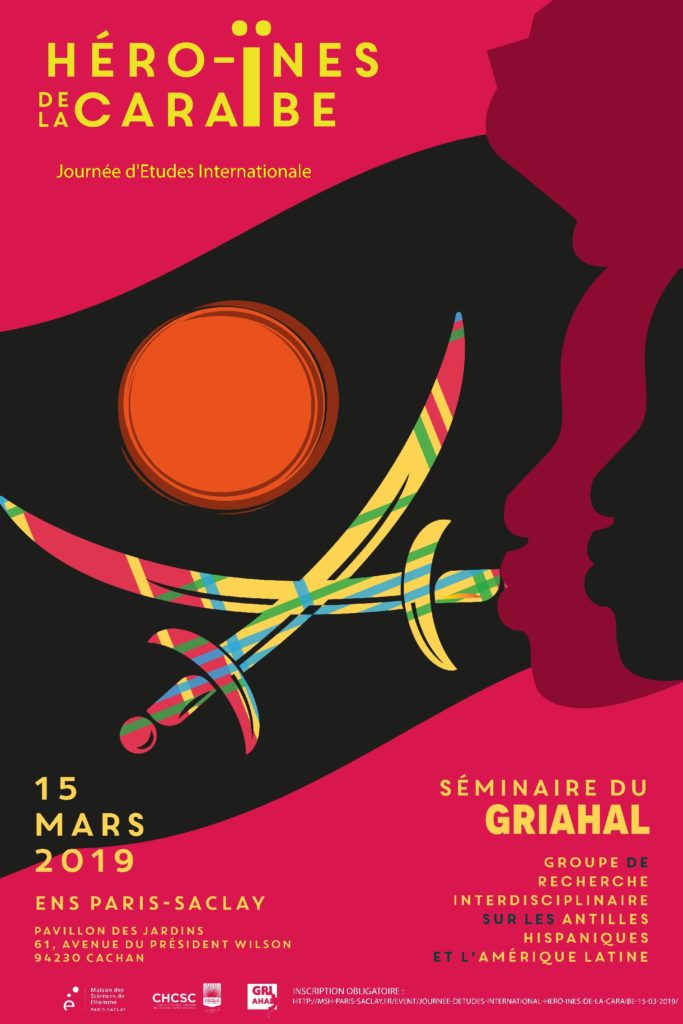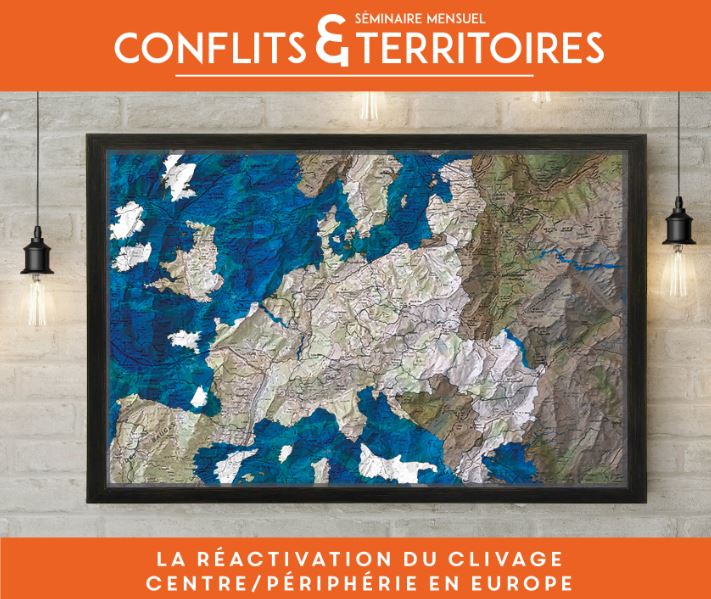Séminaire Les libertés numériques – 5/03/2020
Jeudi 5 mars 2020 – Les atteintes aux libertés numériques – Amphi Guizot
A l’exception de certains droits cardinaux, comme le droit à la dignité, les droits fondamentaux tolèrent des restrictions. Quels sont les motifs d’atteintes aux droits fondamentaux du numérique ? De la protection de l’ordre public et de la sécurité publique, jusqu’à la surveillance des salariés par leur employeur, il est nécessaire d’interroger ces limites.
- Félix Tréguer, chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS et post-doctorant au CERI-Sciences Po : Généalogie de la censure : le contrôle d’Internet au prisme de la raison d’Etat.
Inscription ici.
A propos du séminaire :
Open data, transparence des algorithmes, éthique by design, droit à l’oubli numérique, autodétermination informationnelle, reconnaissance faciale, neutralité du net, souveraineté numérique, justice prédictive, etc. autant de sujets qui animent ces dernières années le débat public concernant l’environnement juridique du numérique.
Ces sujets soulèvent une question commune : quels seront demain les droits et libertés fondamentales reconnus à chacun dans l’univers numérique? La réponse à cette question impose un examen transversal de ces différents sujets : notre intuition est qu’une approche globale des libertés numériques est aujourd’hui impérative.
A l’heure où se multiplient les projets de reconnaissance constitutionnelle et européenne des droits fondamentaux du numérique, et où le Conseil de l’Europe élabore des instruments juridiques relatifs à la gouvernance de l’Internet, ce cycle de conférences propose un échange interdisciplinaire autour de l’étude de leurs fondements, leurs enjeux, leur nature et leur mise en oeuvre.
En savoir plus : https://libertes-numeriques.com/
Séminaire Les libertés numériques – 5/03/2020 Lire la suite »