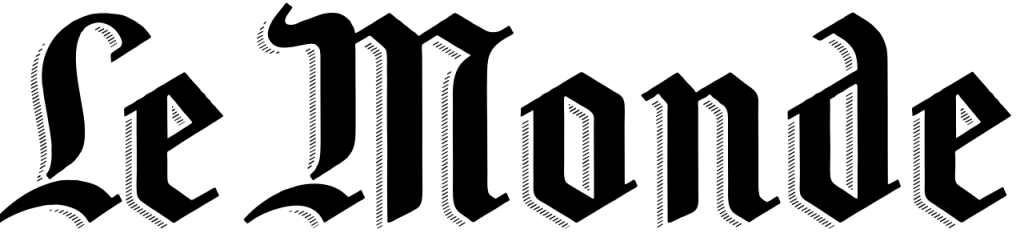La chronique philo de Cynthia Fleury. La psychiatrie sous tension
En tant que révélateur, la crise du Covid-19 a joué plusieurs rôles, notamment celui de mettre en exergue l’extrême pénurie du secteur psychiatrique. Alors que nous sortons des Assises de la psychiatrie (2021), Daniel Zagury, psychiatre des hôpitaux honoraire, a pris la plume dans Comment on massacre la psychiatrie française (Éditions de l’Observatoire, 2021), pour un constat sans nouveauté aucune, et cinglant. Depuis plusieurs décennies, la psychiatrie ne cesse d’augmenter l’empêchement de son exercice, par une administration de plus en plus bureaucratique, gestionnaire, à côté de la plaque, vindicative, contradictoire, le tout avec 1 200 postes non pourvus, pour 2,3 millions de citoyens français usagers de la psychiatrie. Une « quotidienneté du désastre » décrite par l’auteur ainsi : des unités d’hospitalisation saturées, un usage immodéré de la contention et de l’isolement, une augmentation des hospitalisations sous contrainte, des traitements indignes des patients, un effondrement de la qualité des soins, des gardes infernales, un personnel de plus en plus absent, ou en burn-out, une disparition totale de l’idéal de métier, des cadres infirmiers happés par la hiérarchie administrative, des erreurs médicales, une obligation d’évaluation permanente des services alourdissant la tâche. Au milieu, un chef de service sans pouvoir qui n’arrive plus à former un binôme salvateur avec son cadre infirmier supérieur. Petit détour par Bondy, un soir de week-end : service en ébullition et personnel médical et infirmier archi-manquant : une patiente en état d’excitation délirant de type maniaque, venant de faire un geste suicidaire, partie dans les chambres toucher les parties génitales des autres patients, dont celles d’un adolescent présentant un trouble du spectre de l’autisme, très angoissé, mobilisant une présence soignante importante, face à une famille très déstabilisée avec laquelle il est tout aussi compliqué d’interagir. À côté, un patient présentant un épisode délirant sur fond de personnalité psychopathique. Un autre, très angoissé, adhésif et persécuté ; un autre encore, adolescent de 19 ans, suite à un raptus suicidaire ; deux patients âgés, l’une de 91 ans, très hostile aux soins, désinhibition, poussées inquiétantes d’hypertension artérielle, et l’autre de 72 ans souffrant d’un syndrome frontal. C’est une spécificité de la psychiatrie : l’interaction complexe et parfois dangereuse entre les patients, ce qui nécessite des protocoles très vigilants. Qu’il est loin le temps des grands noms de la psychiatrie, Ey, Daumezon, Racamier, Deniker, Delay, Bonnafé, Lanteri-Laura, Tosquelles, Oury, Paumelle, Torrubia, Mignot, pour ne citer qu’eux. « Il faut réenchanter la psychiatrie », écrit Zagury. « À nier la réalité de sa pratique diversifiée, on l’a appauvrie, on l’a châtrée. On a précipité la fuite des talents. On a transformé cette discipline magnifique en une spécialité inférieure aux autres. » Les nouveaux Pinel et Esquirol doivent se réveiller.
La chronique philo de Cynthia Fleury. La psychiatrie sous tension Lire la suite »