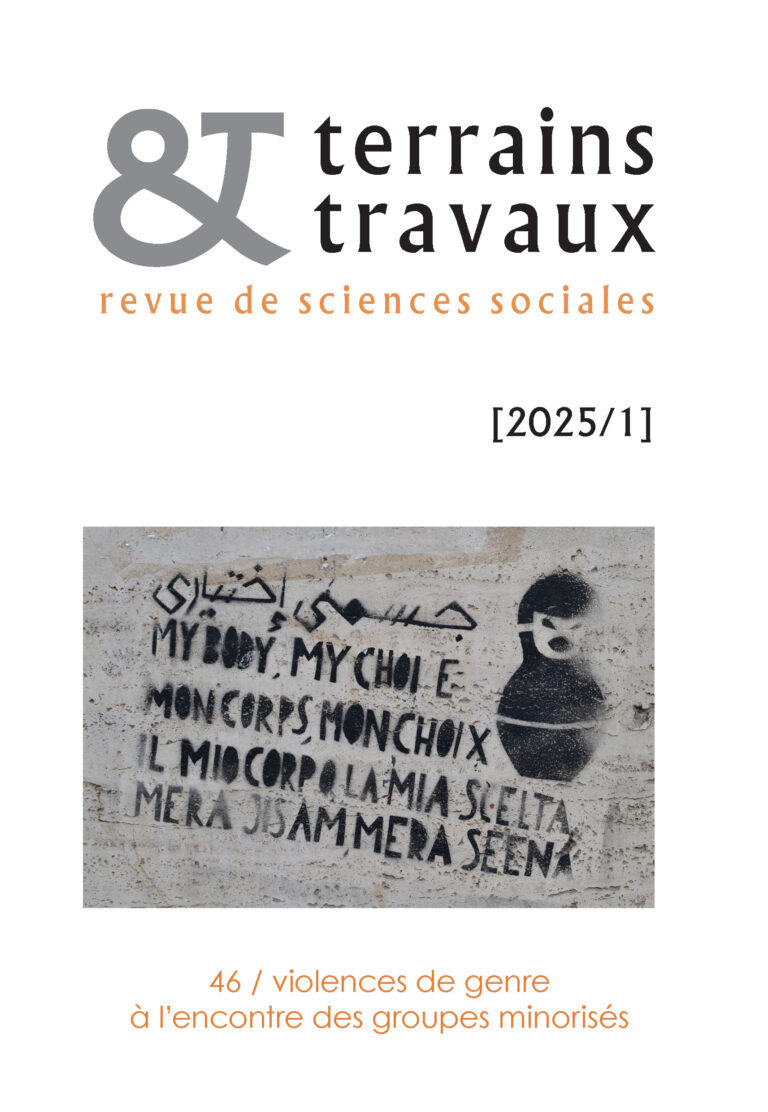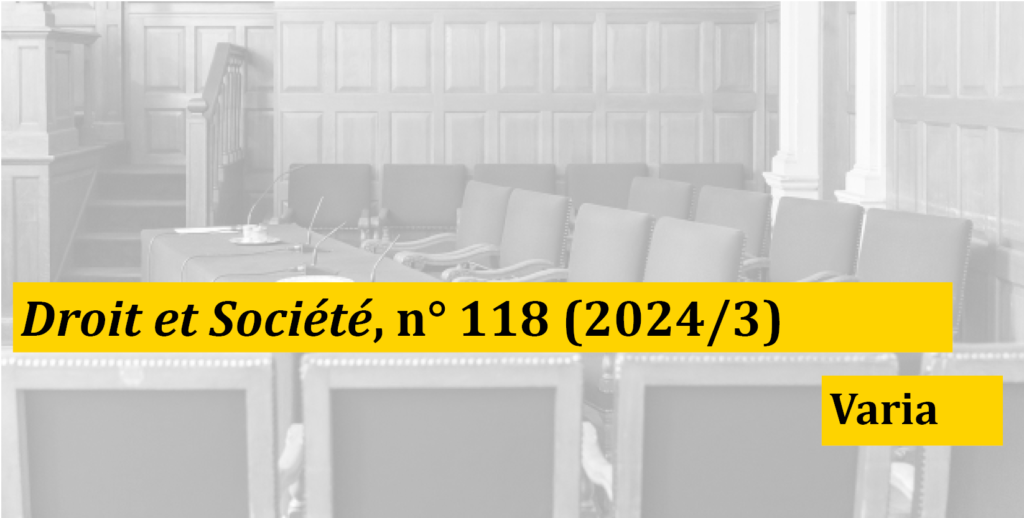Activités scientifiques
Appel à contributions pour terrains & travaux : Promouvoir l’égalité au niveau local
Appel à contributions pour terrains & travaux : "Promouvoir l'égalité au niveau local"
INFORMATIONS
La revue terrains & travaux, accompagnée par la MSH Paris-Saclay, lance un appel à contributions pour son dossier thématique : « Promouvoir l’égalité au niveau local ».
Date de clôture de l’appel : 15 janvier 2026
Télécharger ici l’appel au format PDF
Présentation de l'appel
Dossier coordonné par : Anouk Flamant (Insei), Gwenaëlle Perrier (Université Sorbonne Paris Nord), Manon Torres (Dares) et Alban Jacquemart (Université Paris-Dauphine/PSL)
Que l’on songe à la décision votée en mai 2022 par le conseil municipal de Grenoble d’autoriser le port du « burkini » dans les piscines municipales ou au plan de mobilisation pour l’accueil des réfugié·es adopté par le Conseil de Paris en octobre 2015, plusieurs « controverses d’égalité »[1] ont, ces dernières années, impliquées des collectivités territoriales. Parallèlement à ces controverses, différentes politiques de promotion de l’égalité s’institutionnalisent depuis le début des années 2000 au niveau local, qu’elles concernent la lutte contre les discriminations ethno-raciales, l’accueil à destination des personnes exilées, la promotion des droits des femmes, des personnes en situation de handicap et plus rarement des minorités sexuelles et de genre. C’est l’ensemble de ces dispositifs visant à lutter contre des inégalités et des discriminations touchant différents groupes sociaux minorisés que ce dossier désigne comme des « politiques d’égalité ».
Ces sujets sont généralement constitués en champs d’étude singuliers dans l’espace académique (études de genre, Migration Studies, Queer Studies, Disability Studies, etc.) et en causes distinctes dans les espaces militants. Pourtant, ces différentes politiques ont pour principale caractéristique commune de transférer des revendications contestataires dans des espaces institutionnels. Les étudier ensemble, dans une optique comparative, permet ainsi de mieux comprendre les processus d’institutionnalisation des causes minoritaires. Ce dossier propose en particulier d’en interroger trois dimensions principales, en tenant compte de la diversité des contextes nationaux.
Des politiques locales dans un environnement multiscalaire
La structuration de politiques locales d’égalité pourra d’abord être interrogée en prêtant attention à l’articulation entre les différentes échelles d’action publique. En fonction des contextes nationaux, ces politiques s’inscrivent dans des histoires tantôt marquées par la primauté de l’intervention étatique en matière de lutte contre les discriminations, comme ce fut le cas en France en matière de promotion des droits des femmes et de l’égalité, tantôt par celle d’actrices et acteurs locaux (collectivités territoriales, associations, etc.), à l’instar de ce qui a pu se passer outre-Rhin dans ce même secteur d’action publique. Des travaux, sur le genre et les migrations notamment, ont aussi montré le rôle des organisations internationales (Union européenne, Banque mondiale, ONU) dans la mise en place d’initiatives locales en faveur de l’égalité.
Le dossier analysera donc les positionnements des actrices et acteurs locaux par rapport à l’État et/ou aux organisations internationales, en insistant non seulement sur les éventuelles spécificités des thématiques portées dans le cadre des politiques locales d’égalité, mais aussi sur les manières dont les États et/ou les institutions internationales cadrent les possibles. Dans quelle mesure la mise à l’agenda et la mise en œuvre de politiques locales d’égalité constituent-elles des canaux de politisation alternative de ces causes (féministe, antiraciste, anti-homophobe, etc.) ? De quelle manière certaines expérimentations locales sont-elles accompagnées ou dénoncées par les pouvoirs étatiques ? Des contributions historiques pourront interroger l’engagement précoce de certain·es acteurs et actrices locales (mairies, collectivites territoriales, associations, etc.) pour favoriser la promotion de causes égalitaires, par exemple quand l’État les a délaissées. Plus largement, les contributions attentives aux circulations des acteurs et actrices, des discours et cadrages des causes, ou encore des instruments de politiques publiques mobilisés pour mener des politiques locales d’égalité sont attendues.
Les acteurs et actrices locales de l’égalité
Les politiques locales d’égalité sont directement mises en œuvre par des acteurs et actrices dans les collectivités locales, les services déconcentrés de l’État ou les établissements publics. Les contributions pourront analyser ces personnels pour saisir leurs caractéristiques, leurs trajectoires, leur inscription dans l’espace local des causes minoritaires et la manière dont elles et ils investissent leurs fonctions. Il s’agira en particulier d’analyser leurs pratiques de travail et leurs potentielles positions de « militant·es de l’intérieur ». Comment coexistent et s’articulent l’allégeance à la cause et l’allégeance à l’institution chez ces professionnel·les ? Plus largement, les contributions sont invitées à interroger les ressources et marges d’action dont ils et elles disposent : quels sont leurs budgets, leurs positions institutionnelles, leur autonomie professionnelle et leurs liens avec l’exécutif politique local ? Quelles sont les coopérations et les circulations professionnelles au sein de ces institutions ?
L’institutionnalisation des causes minoritaires au niveau local implique également toute une série d’autres actrices et acteurs : les exécutifs politiques, des services en charge d’autres politiques, les associations, les syndicats, les universités, les délégué·es du défenseur des droits, les entreprises, etc. Les contributions sont ainsi invitées à développer des analyses éclairant les configurations locales d’acteurs et d’actrices. Quelles sont les logiques de coopération, de concurrence et d’interdépendance ? Observe-t-on des circulations de personnes, de savoirs et de pratiques ? La proximité des politiques d’égalité avec les mouvements sociaux joue-t-elle en leur faveur, ou participe-t-elle au contraire à leur dévaluation ? Observe-t-on, dans un même espace local, de fortes variations selon les causes ou, au contraire, voit-on se dessiner un espace structuré des causes minoritaires ?
Les conséquences des politiques d’égalité pour leurs destinataires
L’étude comparée des politiques locales d’égalité permet également de s’intéresser aux destinataires. L’enjeu de cet axe est de saisir les conséquences de ces actions locales en faveur de l’égalité sur des individus ordinaires qui en sont la cible, mais aussi sur celles et ceux qui se positionnent comme des représentant·es collectif·ves des personnes concernées par ces discriminations.
La conception et la mise en œuvre de ces politiques supposent un travail de définition des publics visés (femmes, immigré·es, personnes LGBT+ ou handicapées, etc.). Il s’agit donc d’abord d’interroger les conséquences de la production de ces catégories sur les individus destinataires de ces politiques, mais aussi sur l’ensemble des acteurs et actrices engagées dans ces politiques. Des contributions analysant les effets des catégories mobilisées par ces politiques sont ainsi particulièrement attendues. Elles pourront s’intéresser aux expériences individuelles et collectives des personnes concernées en ayant une attention sur leurs trajectoires de vie et d’engagement, dans une perspective contemporaine et historique. Ces politiques activent-elles des pratiques attirant ou au contraire marginalisant certains publics ? L’auto-définition des individus entre-t-elle en concurrence avec les définitions institutionnelles ? À quelles conditions certaines populations peuvent-elles ou non se saisir de ces politiques en leur faveur ? Les contributions pourront aussi rendre compte des conséquences de ces initiatives locales pour les associations existante et leurs évolutions. Les potentielles hybridations entre différentes catégories de publics sont ainsi susceptibles d’agir sur les acteurs et actrices défendant une cause. Quelles tensions émergent du chevauchement des catégories de genre, de race, de classe ou de handicap dans les politiques locales ? Quelles formes de conflictualité ou de solidarité naissent de ces redéfinitions des publics ciblés ?
Cet axe conduit aussi à s’interroger sur les conséquences concrètes de l’action menée dans cet espace local de l’égalité. L’enjeu est de saisir les effets contraignants mais aussi habilitants sur les destinataires de l’action publique. Comment l’existence de politiques de lutte pour l’égalité de genre au niveau local affecte-t-elle l’expérience des militantes de la cause des femmes ? Quels sont les effets pour les personnes en situation de migration de vivre dans un territoire se revendiquant comme « accueillant » ? De quelle manière les politiques volontaristes en matière de participation des personnes en situation de handicap impactent-elles leurs trajectoires d’engagement ? Quels sont les savoirs et savoirs-faire que ces personnes acquièrent et comment les mobilisent-elles ?
[1] Juliette Rennes, « Les controverses d’égalité en droit en régime républicain », in Badie Bertrand, Déloye Yves (dir.), Le Temps de l’État, Paris, Fayard, 2007 : 408-419.
Consignes de soumission
Ce dossier réunira des articles empiriques originaux de différentes disciplines de sciences sociales. Les articles sur d’autres cas nationaux que la France sont encouragés.
Les articles de 50 000 signes maximum (espaces, notes et bibliographie compris) doivent être accompagnés de 5 mots clés et d’un résumé de 150 mots, en français et en anglais. Les articles sont attendus pour le 15 janvier 2026 et doivent être envoyés à :
- Anouk Flamant – anouk.flamant@insei.fr
- Gwenaëlle Perrier – perriergwen@yahoo.fr
- Manon Torres – manontorres4@gmail.com
- Alban Jacquemart – alban.jacquemart@dauphine.psl.eu
Les consignes relatives à la mise en forme des manuscrits sont consultables sur le site de la revue : http://tt.hypotheses.org/consignes-aux-contributeurs/mise-en-forme
terrains & travaux accueille par ailleurs des articles hors dossier thématique (50 000 signes maximum), qui doivent être envoyés à :
- Géraldine Farges – geraldine.farges@u-bourgogne.fr
- Jean-Noël Jouzel – jeannoel.jouzel@sciencespo.fr
- Maxime Quijoux – maxime.quijoux@lecnam.net
Pour plus de détails, merci de consulter le site de la revue : http://tt.hypotheses.org
Appel à contributions pour terrains & travaux : Promouvoir l’égalité au niveau local Lire la suite »
Parution – Numéro 15 de Biens symboliques / Symbolic Goods : Mondes intellectuels beyrouthins
Numéro 15 de Biens symboliques / Symbolic Goods
Le numéro 15 (2024/2) de Biens symboliques / Symbolic Goods, revue accompagnée par la MSH Paris-Saclay, vient de paraître !
Mondes intellectuels beyrouthins (années 1950-années 1980)
Ce dossier propose une lecture sociohistorique des mondes intellectuels beyrouthins entre les années 1950 et 1980, période au cours de laquelle Beyrouth s’est affirmée comme l’une des capitales culturelles d’un monde arabe en ébullition. Il met en lumière les dynamiques spécifiques de cet espace intellectuel, marqué par la prédominance des acteurs culturels privés, la forte politisation des débats et des lieux de production des idées, ainsi que ses multiples connexions avec les mouvements et pensées politiques du monde arabe, du Sud global et d’Europe. À la croisée de plusieurs disciplines (histoire, sociologie, science politique) et de plusieurs champs de recherche (histoire et sociologie des intellectuel·les, sociohistoire des idées politiques, New Cinema History, etc.), les articles qui le composent interrogent le rôle de Beyrouth comme carrefour et laboratoire des pensées politiques arabes. Ils s’intéressent aux circulations transnationales dont la ville a été le point nodal, aux trajectoires de figures libanaises et arabes ainsi qu’aux institutions et médias qui ont organisé la fabrique sociale des idées politiques (journaux, revues, maisons d’édition, centres de recherche, mais aussi ciné-clubs et centres culturels). S’appuyant sur un riche matériau empirique souvent inédit, ce dossier met ainsi en dialogue des perspectives variées qui contribuent à renouveler aussi bien l’histoire intellectuelle arabe contemporaine que celle des circulations révolutionnaires ayant fait les Global Sixties.
Le numéro est complété par un entretien réalisé par Michela Passini avec les coordinateur·rices d’un projet de recherche sur l’histoire de la traduction en Italie, en rubrique « Traduire », d’une note critique autour de deux ouvrages publiés par des collègues italien·nes autour de l’épistémologie historique, rédigée par Anna Boschetti pour la rubrique « (Re)lire », et, enfin, d’un entretien autour du métier de guide-conférencière conduit par Pablo Livigni pour la rubrique « Métiers ».
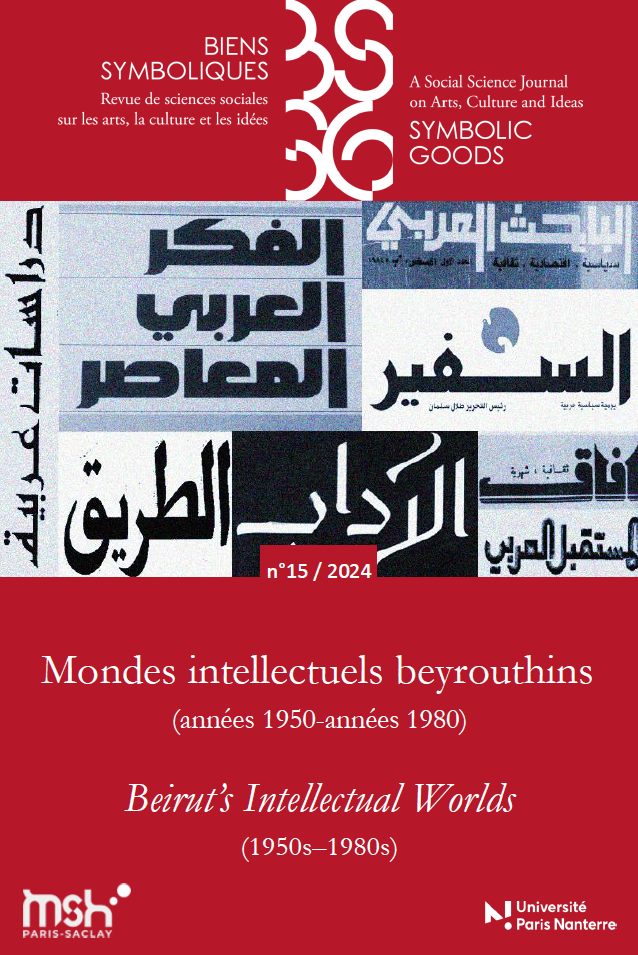
Sommaire
DOSSIER
Sous la direction de Candice Raymond et Aya Khalil
- Pour une histoire sociale des mondes intellectuels beyrouthins (années 1950–années 1980), par Aya Khalil et Candice Raymond
For a Social History of the Intellectual Worlds of Beirut (1950s–1980s) - Beirut, City of Solidarity. The Intellectuals and the Palestinian Cause, 1952–1975, par Sune Haugbolle
Beyrouth, ville solidaire. Les intellectuels et la cause palestinienne, 1952-1975 - S’assembler autour du cinéma arabe alternatif, ou la part ciné-clubiste dans la fabrique des idées (Beyrouth, 1973-1982), par Anaïs Farine
Gathering Around Alternative Arab Cinema: The Role of Film Clubs in the Making of Ideas (Beirut, 1973–1982) - L’arabisme avec et par-delà les défaites. Joseph Samaha : trajectoire sociale d’un intellectuel de la gauche beyrouthine, par Aya Khalil
Arabism With and Beyond Defeat. Joseph Samaha: The Social Trajectory of a Left-Wing Intellectual from Beirut - Committed Cultural Politics in Global 1960s Beirut: National Identity Making at Dar el Fan, par Flavia Elena Malusardi
La politique culturelle engagée du Beyrouth mondialisé des années 1960 : Dar el-Fan et la fabrique d’une identité nationale - Mounir Shafiq : du marxisme à l’islamisme, ou les conversions sans rupture d’un intellectuel révolutionnaire palestinien au Liban, par Nicolas Dot-Pouillard
Mounir Shafiq: From Marxism to Islamism; or, the Seamless Conversions of a Revolutionary Palestinian Intellectual in Lebanon - Beyrouth dans les mémoires d’éditeurs libanais et arabes, par Franck Mermier
Beirut Through the Memoirs of Lebanese and Arab Publishers
- Travailler sur l’histoire de la traduction en Italie. Entretien avec Anna Baldini et Michele Sisto autour du projet LTit, par Michela Passini
(RE)LIRE
- L’épistémologie historique en train de se faire, par Anna BoschettiNote critique sur : Massimiliano Badino, Gerardo Ienna & Pietro Daniel Omodeo (2022). Epistemologia storica. Correnti, temi e problemi. Roma, Carocci ; et Gerardo Ienna (2023). Genesi e sviluppo dell’épistémologie historique. Fra epistemologia, storia e politica. Lecce-Rovato, PensaMultiMedia Editore.
MÉTIERS
- Vivre du patrimoine et faire vivre le patrimoine. Entretien sur le métier de guide-conférencière avec Chloé Merccion, présidente de la FNGIC, par Pablo Livigni
Diffusion
Ce numéro est disponible en version numérique (en accès ouvert immédiat) sur le OpenEdition Journals.
Séance 3 : Impact de l’IA sur la recherche en médecine 31 mars 2025
Séminaire Centre d'alembert - séance 3
Penser et agir autrement avec l'Intelligence artificielle?
Pierre-Antoine Gourraud est professeur des universités en médecine à Nantes Université et praticien-hospitalier au CHU de Nantes. Auteur (h-index de 59) de plus de 180 publications cumulant plus de 13 500 citations, ses activités de recherche se positionnent au carrefour de
l’immunologie, de la génétique et du traitement informatique des données de santé. Enseignant versé dans la bio-informatique et la biologie cellulaire, il pratique les ressources éducatives libres depuis plus de 10 ans avec le MOOC de Biologie cellulaire « Cellules & Cellules Souches » et le parcours d’anglais médical « Road 66 to Medical English ». »
Mise en œuvre d’un entrepôt de données biomédicales : De la conception à l’application clinique dans un centre hospitalier universitaire français régional – Dévoiler les processus, surmonter les défis et extraire des connaissances cliniques.
L’exploitation des données de santé est un enjeu majeur pour la recherche et la prise de décision clinique. Cette conférence propose un retour d’expérience sur la mise en place de l’entrepôt de données biomédicales (EDB) du CHU de Nantes, de sa conception à son utilisation effective.
Nous aborderons les défis rencontrés : transformation organisationnelle, architecture technique, gouvernance des données et conformité réglementaire. Nous explorerons également l’impact de cet outil sur la recherche et l’aide à la décision, en illustrant son potentiel par des exemples concrets. Enfin, nous discuterons du rôle central de la gouvernance des données dans une stratégie institutionnelle intégrant les professionnels de santé et les patients.
Stéphanie Allassonnière est professeur de mathématiques appliquées à l’UFR de médecine de l’université Paris Cité et Vice-Présidente en charge de l’innovation et la valorisation,
Suivi d’un débat animé par Julien Gargani, Directeur du Centre d’Alembert et Pierre Nicolas, Directeur de Recherche, INRAE.
Séance 3 : Impact de l’IA sur la recherche en médecine 31 mars 2025 Lire la suite »
Appel à projets inter-MSH 2025
Appel à PROJETS inter-mSHS 2025
INFORMATIONS
Ouverture de l’appel à projets inter-MSH 2025
Le Groupement d’Intérêt Scientifique Réseau national des Maisons des Sciences sociales et des Humanités lance un appel à projets blanc inter-MSH. Cet appel a pour objectif d’apporter un soutien à des projets de recherche en incubation, émergents, visant une mise en réseau ou un changement d’échelle.
Ces projets de recherche seront portés par au moins un chercheur ou enseignant chercheur en porteur principal.
La spécificité de cet appel à projets non thématique est d’encourager les collaborations de recherche entre des équipes appartenant, au moins, à deux MSH et de privilégier les pratiques effectives et équilibrées d’interdisciplinarité internes aux sciences humaines et sociales ou en relations avec d’autres sciences.
Une attention particulière sera accordée aux projets développés en relation avec les dispositifs, plateformes ou services mis en place au sein des MSH. Le cas échéant, il est recommandé aux porteurs de projets de contacter en amont de la soumission les services ou plateformes ciblés et de préciser les formes de collaborations envisagées.
Avant tout dépôt de projet, les directions des MSH concernées doivent être consultées. Leur avis écrit sur l’effectivité de la collaboration inter MSH envisagée sur le projet, leur visa et leur soutien conditionne la recevabilité du projet.
Les projets sélectionnés recevront un financement de 24 mois compris entre 5 000 € et 25 000 €. Toutes dépenses permettant de réaliser le projet sont autorisées, dans la mesure des règles propres aux établissements gestionnaires dont dépendent les UAR-MSH qui recevront le financement. Ce sont les UAR-MSH qui gèrent le budget alloué. Il leur est demandé d’envoyer au Gis RnMSH, dans les 6 mois suivant la clôture du projet des justificatifs financier et scientifique, selon un modèle envoyé par le RnMSH.
Le formulaire de soumission du projet est disponible ICI. Il ne devra pas dépasser 9 pages et sera obligatoirement visé par les directions de MSH concernées.
La date limite : lundi 2 juin 2025 (23h59)
Modalités de dépôt : merci de transférer vos projets sur notre espace Sharedoc via ce lien, sous format pdf en un seul fichier intitulé comme suit : Nom du porteur principal-MSHx-MSHy-MSHz_rnmsh2025
Un accusé de réception vous sera envoyé à l’adresse du porteur principal indiqué dans le dossier, dans les jours suivants.
calendrier
Calendrier :
- Mi-mars : lancement de l’appel à projets
- Lundi 2 juin 2025 (23h59) : date limite de dépôt des projets
- Jusqu’à fin septembre 2025 : expertise et évaluation des projets
- Fin octobre : annonce des résultats
- Janvier 2026 (au plus tôt et après avoir établi une convention avec l’établissement gestionnaire si gestion non cnrs) : date de démarrage des projets
Critères pris en compte pour l’évaluation
- 1. Finalité et clarté des objectifs
- 2. Faisabilité du projet
- 3. Qualité scientifique et méthodologie, caractère innovant
- 4. Effectivité et qualité de la dynamique inter-MSH (dont implication des plateformes technologiques et des services des MSH)
- 5. Effectivité et qualité de l’approche interdisciplinaire (intra-SHS) ou intersectorielle (collaboration hors SHS)
- 6. Qualité de la gestion des données (plan de gestion des données) avec l’implication des plateformes des MSH si cela est pertinent
- 7. Composition et qualité de l’équipe de projet, implication de jeunes chercheurs
- 8. Cohérence et justification du budget
Appel à projets inter-MSH 2025 Lire la suite »
Numéro 220 de L’Homme & la Société : La spécificité critique du féminisme
Numéro 220 de L'Homme & la Société : La spécificité critique du féminisme
Le numéro 220 (2024/1) de L’Homme & la Société, revue accompagnée par la MSH Paris-Saclay, est paru !
La spécificité critique du féminisme
Coordonné par Pierre Bras, Michel Kail & Richard Sobel
L’idée qui a inspiré la thématique de ce numéro de L’Homme & la Société est celle de la longue durée de la domination masculine en vue d’en mesurer les effets sur la théorie et la pratique féministes.
Ce volume s’inscrit dans une réflexion plus ancienne que mène L’Homme & la Société à partir d’une ligne éditoriale qui s’efforce d’articuler une dimension analytique déroulée dans la perspective de l’antinaturalisme et une dimension politique développée à son tour selon la perspective de l’autoémancipation. Les exigences antinaturalistes étant comblées par l’ambition autoémancipatrice, laquelle puise dans l’antinaturalisme les conditions de sa possibilité sinon de sa nécessité. Et plus encore, il s’inscrit dans une réflexion sur l’apport du féminisme à la théorie critique auquel la revue a déjà consacré plusieurs dossiers. Comment une conception critique de l’histoire qui se veut libératrice maintient-elle l’effacement des femmes ? Et en retour, comment le féminisme s’impose-t-il comme outil critique des théories libératrices ?
Couverture : Interprétation de l’oeuvre d’art Mandala (2012-2014) de l’artiste Pilar Albarracín © Adagp, Paris, 2025
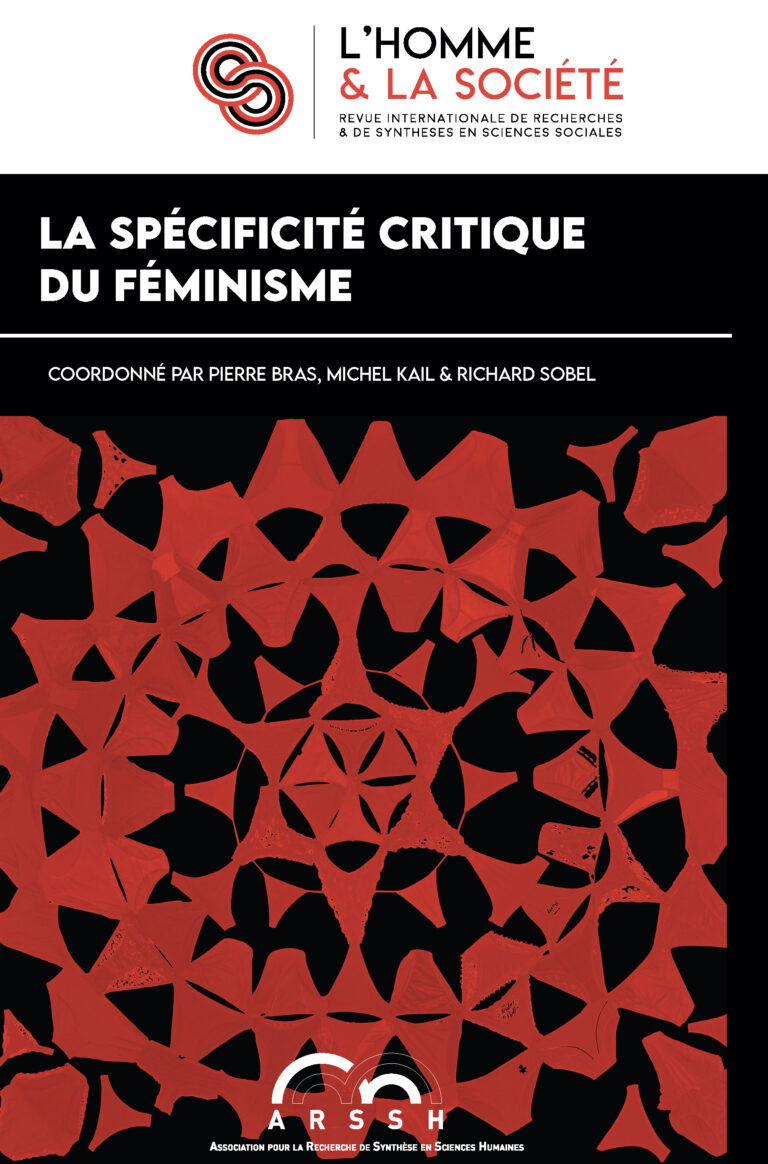
Sommaire
ÉDITORIAL
- La convergence idéologique des droites : l’histoire française d’un tournant autoritaire, par Nicolas Schapira
IN MEMORIAM
- Hommages à Louis Moreau de Bellaing
- Hommage à Louis Moreau de Bellaing, par Judith Hayem
- Hommage à Louis Moreau de Bellaing, par Stéphane Corbin
- Hommage à Louis Moreau de Bellaing, par Marie-Laure Dimon
- Le féminisme de Louis Moreau de Bellaing, par Pierre Bras
- In memoriam, Philippe Chanial, par Stéphane Corbin & Salvador Juan
DOSSIER
- Avant-propos. Pour Claire Etcherelli, par Liliane Kandel
- Introduction. Libérer le projet émancipateur de ses entraves progressistes : la contribution décisive du féminisme, par Pierre Bras, Michel Kail & Richard Sobel
- Inédit. Un chapitre supprimé de L’Invitée : Xavière à 17 ans, par Simone de Beauvoir
- Zaza s’évade (à propos d’un chapitre supprimé de L’Invitée), par Pierre Bras
- Féminisme-marxisme, un divorce nécessaire, par Michel Kail
- Désandrocentrer la contestation : féminismes et travail reproductif, par Fanny Gallot & Hugo Harari-Kermadec
- La lutte des ouvrières de Vertbaudet : une grève féministe !, par Rachel Silvera
- Féminisme et pacifisme. Retour sur l’antimilitarisme de Jane Addams, par Quentin Revol
- Alexandra Kollontaï et la signification politique de l’amour, par Almira Ousmanova
- Des femmes et du consentement, par Carole Pateman
- Contrat social, contrat sexuel et régime d’historicité, par Richard Sobel
- Du consentement dans les ouvrages récents, par Michel Kail
- Construction épistémologique et historicité. Entretien avec Geneviève Fraisse, par Michel Kail
- La question du féminisme dans l’histoire de la revue
- Compte-rendu de « Libération des femmes : année zéro », Partisans, n° 54-55, 1970, par Christiane Rolle & Nello Zagnoli
- Mai 68 : qu’est-ce qu’un mouvement social ? Au-delà du mouvement ouvrier, par René Gallissot
- Éléments pour un matérialisme féministe. Philosopher avec Simone de Beauvoir, par Richard Sobel
HORS-DOSSIER
- Claire Michard, sociolinguiste (1938-2024)
- D’une analyse du discours sexiste à une analyse de l’écriture inclusive. Réflexion sociolinguistique féministe matérialiste, par Claire Michard
- Compte-rendu du colloque « Quelles réponses face à la “théorie” du grand remplacement ? » (Assemblée nationale). Une réflexion située sur la dialectique recherche – action politique, par Julie Lavialle-Prélois
DÉBATS & PERSPECTIVES
ÉCHO DE L’ÉTRANGER
- Quand les mecs échappent au contrôle. Une anthologie de la littérature gay bélarussienne, par Uładzisłaŭ Harbacki
COMPTES RENDUS
- V. Baraduc, Tout les oblige à mourir…, 2024, par Monique Selim
- G. Pruvost, Quotidien politique. Féminisme, écologie…, 2021, par Ioana Cîrstocea
REVUE DES REVUES 2022-2023
- Les conflits inter- ou intra-sociétaux et l’esprit de la démocratie, par Salvador Juan
Diffusion
Ce numéro est disponible en version électronique ou en version papier à la demande sur le portail Cairn.
Numéro 220 de L’Homme & la Société : La spécificité critique du féminisme Lire la suite »
Numéro 45 de terrains & travaux : Rétribuer les enquêté·es ?
Numéro 45 de terrains & travaux : Rétribuer les enquêté·es ?
Le numéro 45 (2024/2) de terrains & travaux, revue accompagnée par la MSH Paris-Saclay, vient de paraître !
Présentation
Numéro coordonné par Stéphanie Abrial, Pauline Barraud de Lagerie, Margot Delon, Laure Hadj et Efi Markou
Le dossier thématique du numéro, « Rétribuer les enquêté·es ? », est composé d’une introduction générale et de trois articles inédits.
Le numéro comprend également trois articles hors dossier inédits.
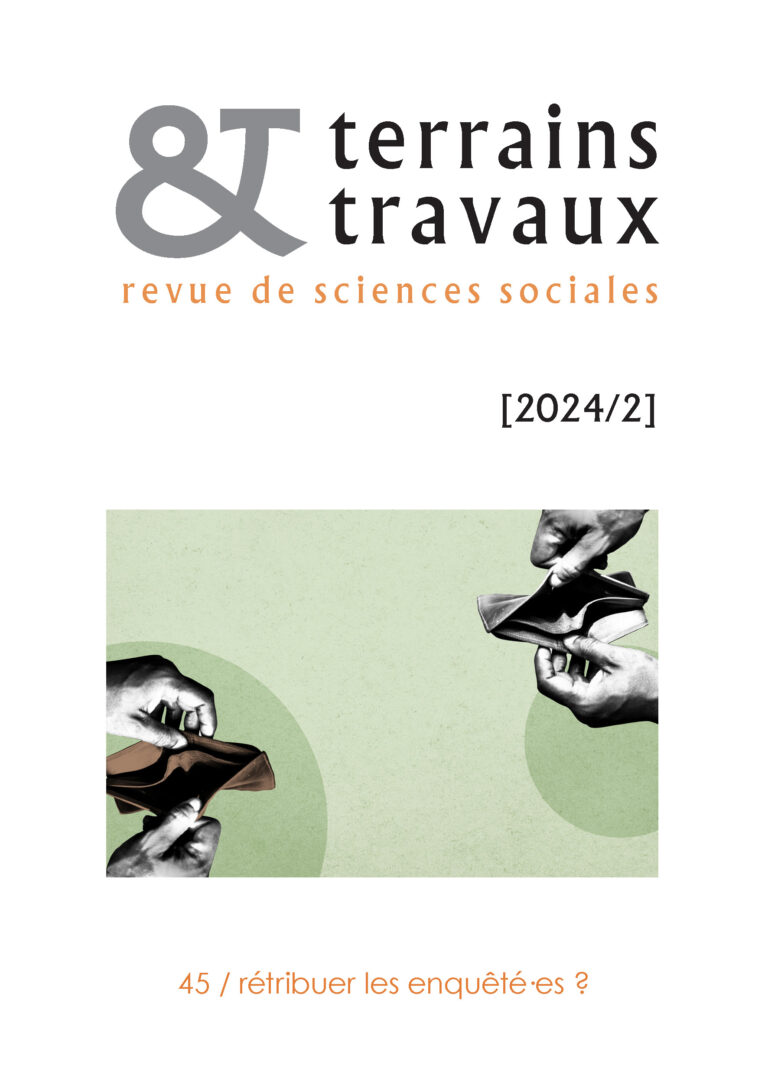
Sommaire
RÉTRIBUER LES ENQUÊTÉ·ES ?
- À l’ombre des enquêtes, les compensations financières et matérielles, Introduction par Efi Markou, Margot Delon, Laure Hadj, Pauline Barraud de Lagerie et Stéphanie Abrial
- Rétribuer des personnes consommatrices de drogues dans des enquêtes sociologiques. Généalogie, mise en pratique et effets, par Estelle Filipe et Marie Jauffret-Roustide
- L’argent dans les relations d’enquête fait-il toujours des histoires ? Les cas croisés des débiteur·rices chroniques en France et des paysan·nes au Burundi, par Pascale Moulévrier
- Combien vaut le bii biêlgee ? Négociations et rétribution d’un patrimoine dansé mongol, par Raphaël Blanchier
HORS DOSSIER
- De « copine de geek » à présidente d’association. L’intégration des femmes dans le milieu de l’internet militant entre opportunité organisationnelle et négociations de l’identité de genre, par Aube Richebourg
- « Un véritable projet d’éducation populaire ». Ambivalence et appropriation du dispositif Démos au sein d’une MJC de Toulouse, par Lionel Arnaud et Laura Barizza
- La notabilisation des acteurs culturels en banlieue rouge (1960-2014). Penser le lien entre capital et espace hors de la gentrification, par Pauline Clech
Diffusion
Ce numéro est disponible en version papier et en version électronique via le portail Cairn.
Numéro 45 de terrains & travaux : Rétribuer les enquêté·es ? Lire la suite »
Parution – Numéro 118 de Droit et Société : Varia
Numéro 118 de Droit et Société : Varia
Le numéro 118 (2024/3) de Droit et Société, revue accompagnée par la MSH Paris-Saclay, vient de paraître !
VARIA
Le numéro 118 (2024/3) de Droit et Société est constitué de sept articles en rubrique Études, et, en rubrique À propos, de la traduction d’un compte rendu intitulé « La branche la plus conservatrice du gouvernement américain », initialement paru dans la New York Review of Books.
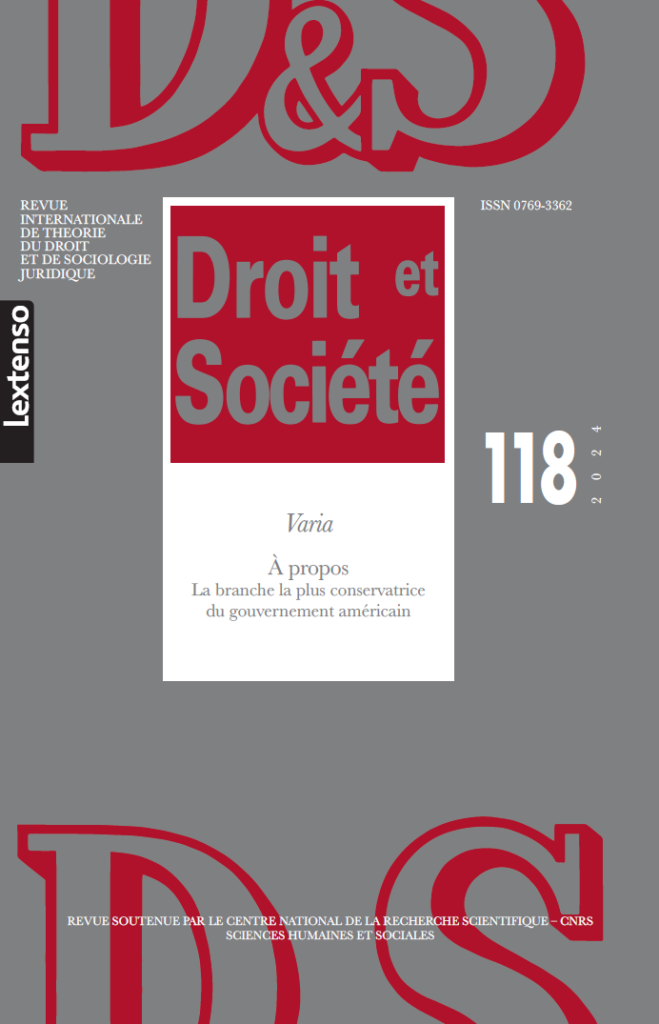
Sommaire
ÉTUDES
- « “Terrorisme”, isolement carcéral et droits humains : dépolitisation et repolitisation de la violence révolutionnaire au cœur de l’Europe des années 1970. Le cas suisse », par Alix Heiniger
- « Ce que la massification du contentieux des violences conjugales fait au travail des professionnels de la chaîne pénale et du secteur associatif », par Marie Cartier, Sylvie Grunvald, Estelle d’Halluin, Pascale Moulévrier et Nicolas Rafin
- « Pression anomique de la numérisation et stratégies juridiques », par Catherine Prébissy-Schnall et Éric Pezet
- « Le pouvoir normatif des fonctionnaires. L’exemple de la création du régime d’enregistrement des installations classées pour la protection de l’environnement », par Laure Bonnaud et Emmanuel Martinais
- « Working Time and Work Intensity in Portuguese Courts », par João Paulo Dias, Paula Casaleiro, Filipa Queirós, Fernanda Jesus and Teresa Maneca Lima
- « Délimiter la communauté de travail. Mises en pratique et controverses autour du principe de l’égalité de traitement », par Camille Dupuy
- « Transactions collusives autour d’un service public de l’eau : une approche ethnographique », par Narcisse Mideso
- « La branche la plus conservatrice du gouvernement américain ? », par Jed S. Rakoff (traduit par Pierre Brunet)
Diffusion
Ce numéro est disponible en version papier auprès des Éditions Lextenso et en version numérique (en accès ouvert immédiat) sur le portail Cairn.
Parution – Numéro 118 de Droit et Société : Varia Lire la suite »
ACTES n° 13 : Contribution de Manuel Bächtold
Numéro 13 de la collection "ACTES" de la MSH Paris-Saclay
Postface. Pourquoi et comment introduire l’histoire des sciences dans l’enseignement scientifique ? Une tentative de mise en perspective des contributions de l’ouvrage
par Manuel Bächtold
Version numérique
Téléchargez gratuitement le PDF : MSHPS_Actes13_Bachtold_Postface
Référence
BÄCHTOLD Manuel, 2024. « Postface. Pourquoi et comment introduire l’histoire des sciences dans l’enseignement scientifique ? Une tentative de mise en perspective des contributions de l’ouvrage », in Laurence Maurines & Christian Bracco (dir.), Apprendre et penser les sciences dans l’enseignement et la formation scientifique. Vers une interdisciplinarité didactique – histoire des sciences – épistémologie. Journée d’étude (MSH Paris-Saclay, 3 juin 2021), Gif-sur-Yvette, MSH Paris-Saclay Éditions, Université Paris-Saclay, p. 209-226. Mis en ligne le 12/11/2024. DOI : https://doi.org/10.52983/IOXQ7482
ACTES n° 13 : Contribution de Manuel Bächtold Lire la suite »
ACTES n° 13 : Contribution de Antonietta Demuro
Numéro 13 de la collection "ACTES" de la MSH Paris-Saclay
Quelques exemples d’interaction entre théorie et empirie dans l’étude statistique de la turbulence (1920-1940). Quel intérêt pour la formation et l’enseignement de la mécanique des fluides d’aujourd’hui ?
par Antonietta Demuro
Version numérique
Téléchargez gratuitement le PDF : MSHPS_Actes13_Demuro_Article
Référence
DEMURO Antonietta, 2024. « Quelques exemples d’interaction entre théorie et empirie dans l’étude statistique de la turbulence (1920-1940). Quel intérêt pour la formation et l’enseignement de la mécanique des fluides d’aujourd’hui ? », in Laurence Maurines & Christian Bracco (dir.), Apprendre et penser les sciences dans l’enseignement et la formation scientifique. Vers une interdisciplinarité didactique – histoire des sciences – épistémologie. Journée d’étude (MSH Paris-Saclay, 3 juin 2021), Gif-sur-Yvette, MSH Paris-Saclay Éditions, Université Paris-Saclay, p. 187-208. Mis en ligne le 12/11/2024. DOI : https://doi.org/10.52983/GZUO3747
ACTES n° 13 : Contribution de Antonietta Demuro Lire la suite »