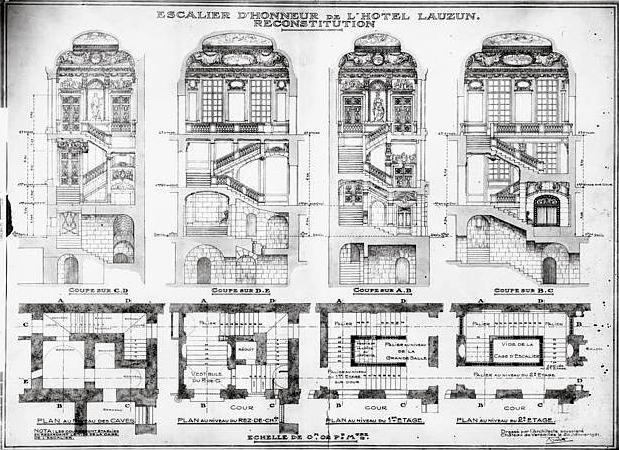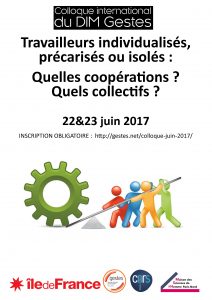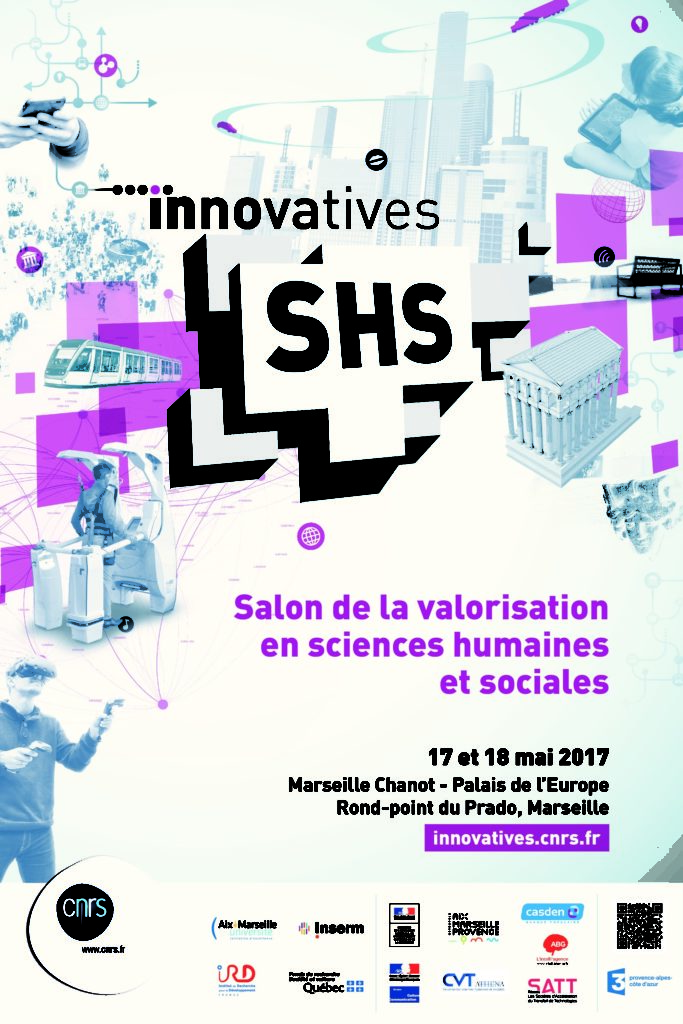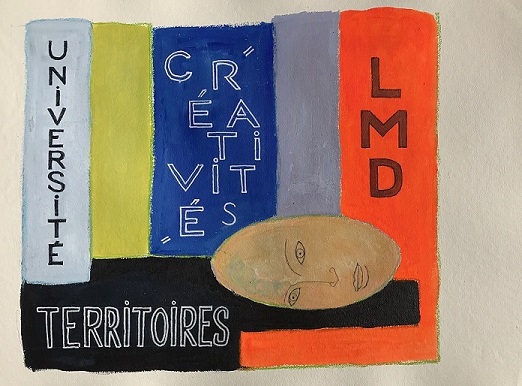L’étude des collectifs de travail se fait généralement dans des métiers et des professions bien définis, stables, partageant une certaine tradition d’engagement collectif et de syndicalisation, avec de faibles turn-over et des moments de coprésences entre salariés permis par l’organisation et l’entreprise. Qu’en est-il quand ces conditions ne sont pas réunies, que l’organisation ne favorise pas les contacts, le sentiment d’appartenir à une même communauté de destin ou du moins d’avoir des intérêts communs ? Dans le cas de l’intérim, du travail indépendant, de la sous-traitance, du télétravail, quand il y a mise en concurrence ou séparation des salariés entre plusieurs établissements ou entités juridiques, peu ou pas de traditions syndicales, etc., comment se construisent le rapport au travail, l’identité ou le genre professionnel, les étayages sociaux, la coopération, la reconnaissance ? Quelles réponses les travailleurs ont-ils, ou non, réussi à donner par le passé aux défis posés par l’isolement ou la mise en concurrence ? Quelles réponses peuvent (ou non) donner les travailleurs aujourd’hui ? Quels sont les effets sur le rapport à la solidarité collective ? Le travail collectif ne se limite pas aux collectifs de travail, quelles autres formes a-t-il pris par le passé ? Quelles autres formes peut-il prendre ? Comment ce travail collectif peut permettre de co-construire le sens de l’activité, les processus de maintien de la santé au travail ? Peut-il aussi être un vecteur de restriction des marges d’autonomie individuelles, un facteur d’exclusion de ceux qui menaceraient les intérêts ou les valeurs du groupe ?
Les nouvelles formes de travail et de management, le secteur des technologies de l’information et de la communication, les mondes de l’art et de la création, l’auto-entreprenariat constituent des terrains possibles, parmi d’autres, pour étudier d’éventuelles formes alternatives de collectif, de nouvelles solidarités, de nouvelles formes d’organisation professionnelles. Mais d’autres emplois et statuts moins touchés par les innovations, en apparence du moins, moins valorisés aussi, figurent également parmi ces travailleurs et travailleuses isolé(e)s et peuvent pareillement être mis en avant. On peut penser, à titre d’illustration, aux chauffeurs ou livreurs travaillant pour des plateformes numériques, aux aides à domicile ou employées de service, au secteur du nettoyage, aux intérimaires, CDD, stagiaires et autres statuts précaires, aux travailleurs sans papiers, etc. Peuvent-ils, et comment, créer du collectif, mettre en débat leur travail et ses conditions de réalisation ? L’ont-ils fait par le passé ? Avec quels effets ?
Les réponses syndicales nouvelles constituent également un sujet possible : syndicats de site, collectifs de travailleurs, mobilisations diverses et transversales, occupations de sites avec des associations de la société civile, etc. Bref, toutes les façons particulières de faire collectif, qui mélangent du classique et de l’inédit. La question des nouvelles formes d’organisation juridique de représentation du personnel (représentation dans les franchises, réseaux…) et de leur mise en œuvre serait également intéressante à prendre en compte.
Programme
Jeudi 22 juin 2017
9h : Café d’accueil
9h30-9h45 : Introduction par Sophie Bernard et Marc Loriol
9h45-12h30 : Session 1. Les travailleurs créatifs isolés
(Présidence : Claire Edey-Gamassou)
Jean-Pierre Durand (Centre Pierre Naville, Univ. Evry-Paris Saclay) : Quels collectifs pour les « nouveaux tâcherons » créatifs ?
Olivier Crasset (Centre nantais de sociologie, UMR 6025) : L’entraide entre artisans : entre solidarité et transmission des normes.
Yannick Fondeur (Cnam, Lise/CNRS UMR 3320, CEET) : Le travail « indépendant » dans les métiers du numérique.
Jacques Marc (INRS) : Suffit-il d’un collectif pour ne pas se sentir isolé ?
12h30-14h : Déjeuner
14h-17h : Session 2. De l’émergence de collectifs de travailleurs indépendants aux mobilisations collectives
(Présidence : Corinne Perraudin)
Sarah Abdelnour et Sophie Bernard (IRISSO, UMR CNRS 7170, PSL Research University, Univ. Paris Dauphine) : La mobilisation improbable des travailleurs des plates-formes chauffeurs VTC.
Cindy Felio (Univ. Bordeaux Montaigne, MICA, EA 4426), Jean-Yves Ottmann (Univ. Paris-Dauphine, PSL Research University, CNRS UMR 7088, DRM M&O), Mélissa Boudes (Univ. Paris-Dauphine, PSL Research University, CNRS UMR 7088, DRM MOST), Sarah Mokaddem (Univ. de Bretagne Occidentale, IAE Brest) : Contourner la solitude de l’autonomie : comparaison de formes émergentes de collectifs de travailleurs indépendants.
Mathieu Hocquelet (JFK Institute, Freie Universität Berlin) : Organiser et mobiliser les employé.e.s des multinationales des services aux États-Unis: entre restructurations industrielles et syndicales.
Camille Peugny (CRESPPA-CSU) : Un collectif de travail introuvable ? Le cas des femmes de ménage employées par une grande entreprise de services à la personne.
17h-17h15 : pause-café
17h15-19h : Anne Bory (CLERSE-Univ. de Lille 1) et Lucie Tourette (réalisatrice) :
Présentation et projection du documentaire « On vient pour la visite » (2013).
Résumé : A Paris, en 2009, plus de 6 000 sans-papiers en grève demandent leur régularisation. En situation irrrégu-lière, Mohamed, Diallo, Hamet travaillent pourtant légalement depuis des années dans la restauration, le nettoyage ou le bâtiment. Ils investissent toute leur énergie dans cette bataille : une fois leur clandestinité révélée au grand jour, impossible de revenir en arrière. Leurs patrons se retrouvent au centre du conflit : la loi demande leur accord préalable pour toute régularisation. Mais les sans-papiers doivent trouver les moyens de leur arracher cet accord : leurs employeurs savent que les sans-papiers n’accepteront plus les mêmes conditions de travail une fois régularisés. Des patrons d’agences 3 d’intérim le disent sans rire en ouverture du film : ils manquent de personnel « prêt à faire n’importe quoi. » Au fil des occupations d’entreprises aussi bon enfant que risquées, les sans-papiers prennent confiance dans leur lutte. En tant que sans-papiers, ils risquent à tout moment l’arrestation, mais en tant que travailleurs, ils ont le droit de faire grève et d’occuper leur lieu de travail. Aidés par des syndicalistes, ils apprennent au fil des semaines à négocier avec des patrons retors et à obtenir d’eux ce qui semblait hors de portée quelques temps auparavant. Pour la première fois, une caméra a pu filmer sans restrictions tout le quotidien de cette grève pendant plusieurs mois. Réunions de grévistes, négociations avec les employeurs, discussions avec la police : On vient pour la visite suit au plus près le désemparement, le courage, les conflits et la camaraderie des sans-papiers, qui apprennent la grève en la faisant.
Vendredi 23 juin 2017
9h-12h : Session 3 : Les réponses syndicales à l’isolement au travail
(Présidence : Arnaud Mias)
Camille Dupuy (DySoLab, Univ. de Rouen) : Rajeunir et réinventer le syndicalisme ? Représenter les salariés du monde associatif
Alexandra Garabige (INED/CEET) : Le droit comme ressource pour les mobilisations syndicales : le cas de l’aide à domicile en France.
Gaëtan Grafteaux (Univ. de Bordeaux, COMPTRASEC /UMR CNRS 5114) : La santé au travail dans les collectivités de travail éclatées. Quelle place pour les représentants du personnel ?
Christian Papinot (GRESCO, EA 3815, Univ. de Poitiers) : Externalisation de gestion des ressources humaines et répercussions endogènes sur les collectifs de travail.
12h-13h30 : Déjeuner
13h30-15h : Session 4 : Travailler chez soi
(Présidence : Isabel Odoul-Asorey)
Gaëtan Bourmaud (ergonome consultant et professeur associé, Paris 8) : L’expérience du télétravail et d’une forme d’isolement comme vecteur pour l’élaboration de nouveaux modes d’organisation de travail à l’adresse d’un collectif pouvant nouvellement télé-travailler.
Djaouida Séhili et Tanguy Dufournet (Centre Max Weber – Université Lumière Lyon 2), L’essor du travail chez soi et modalités spécifiques d’organisation du travail « multi-située ». Vers de nouveaux enjeux de sociabilité et d’affectivité spatiotemporels ?
Pour télécharger le programme : programme-colloque_gestes_juin2017
Inscription gratuite mais obligatoire.
Adresse du colloque
MSH Paris nord
20 avenue George Sand
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS
Métro ligne 12 – station Front Populaire