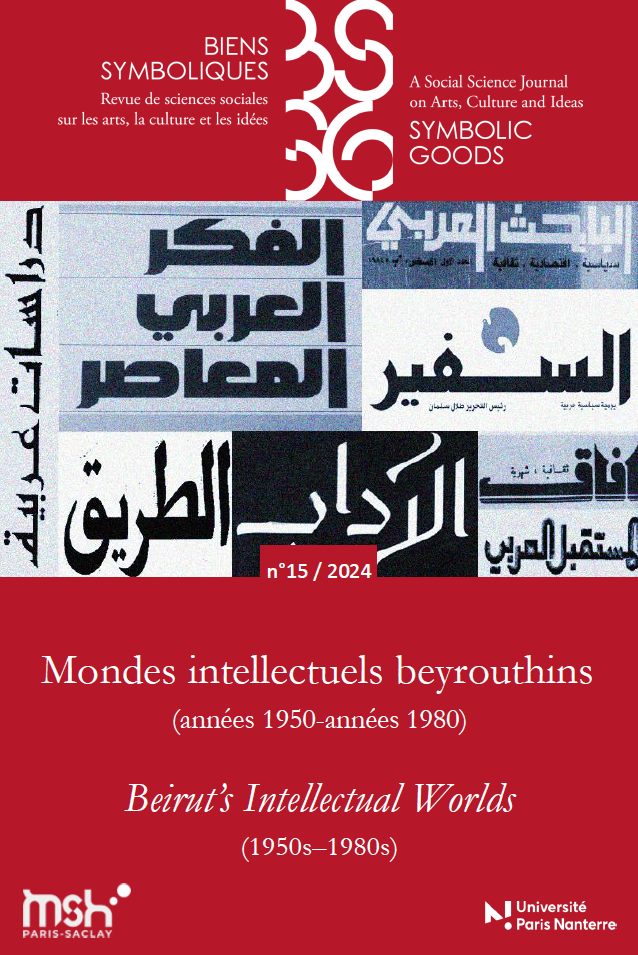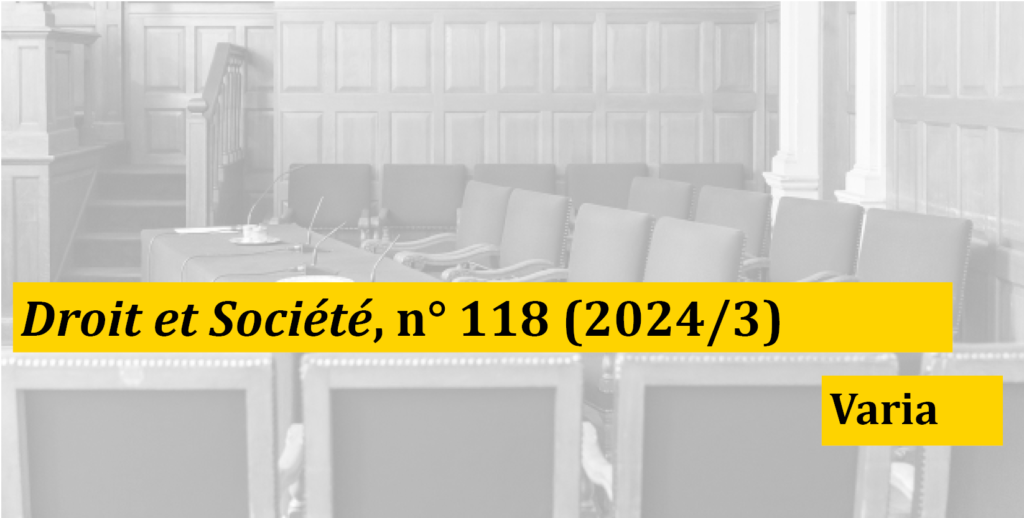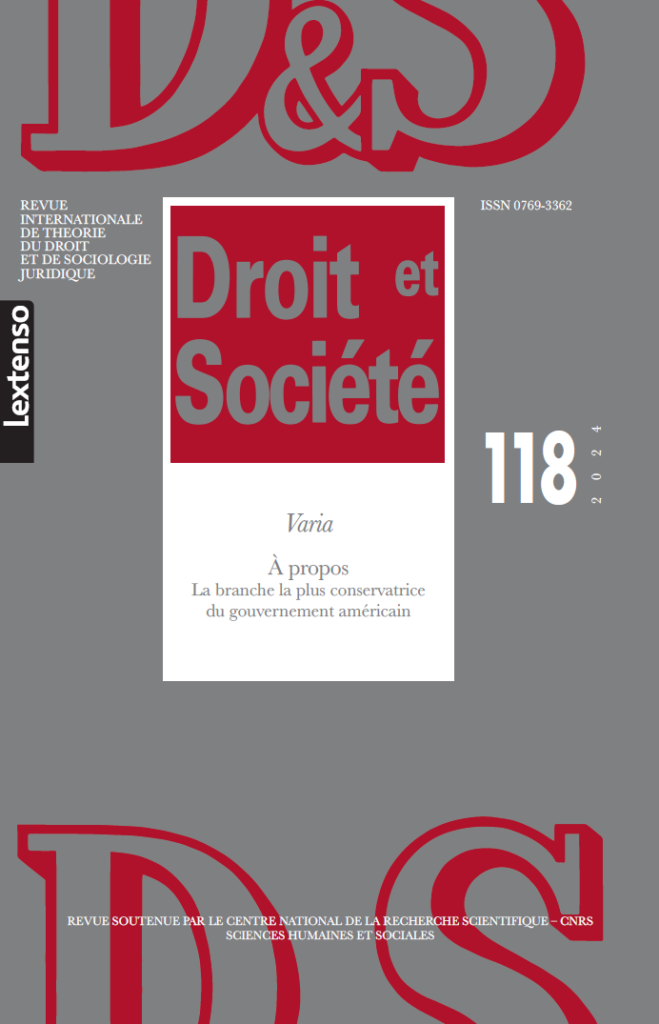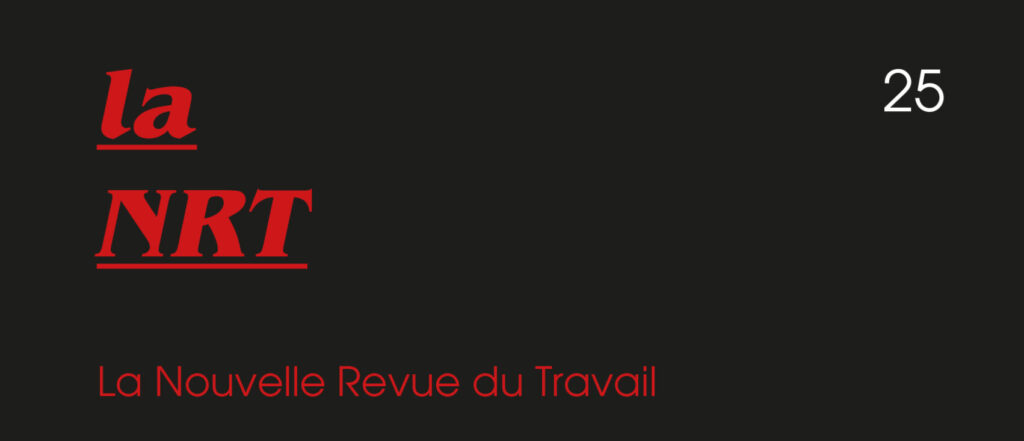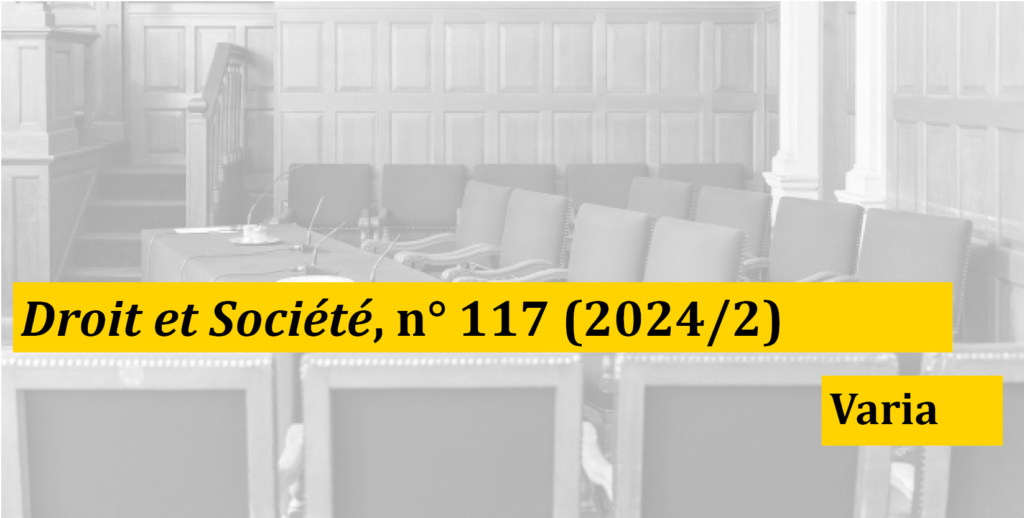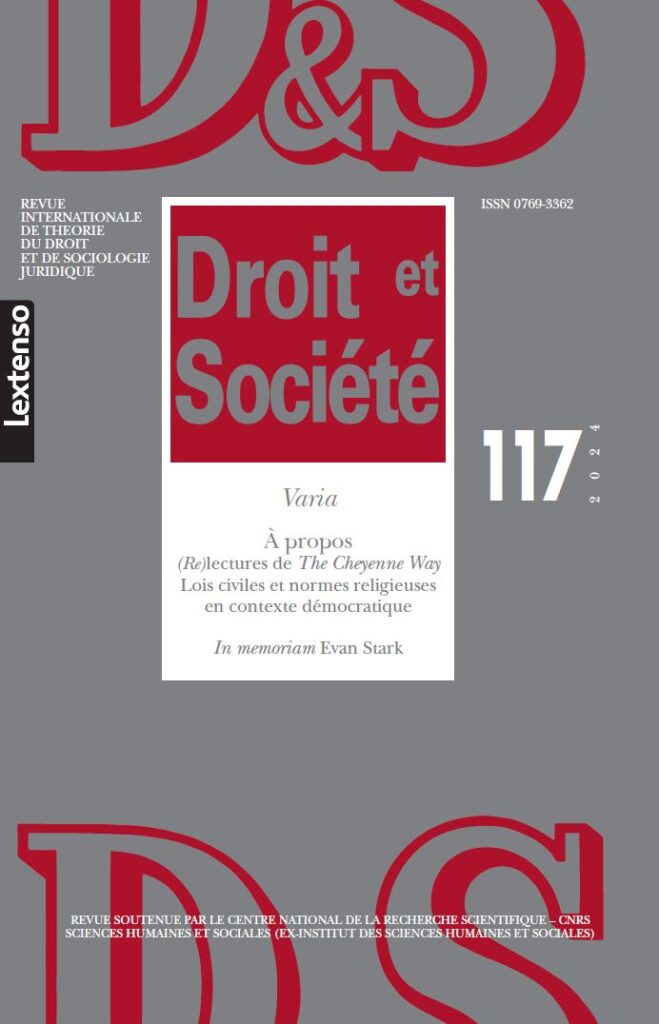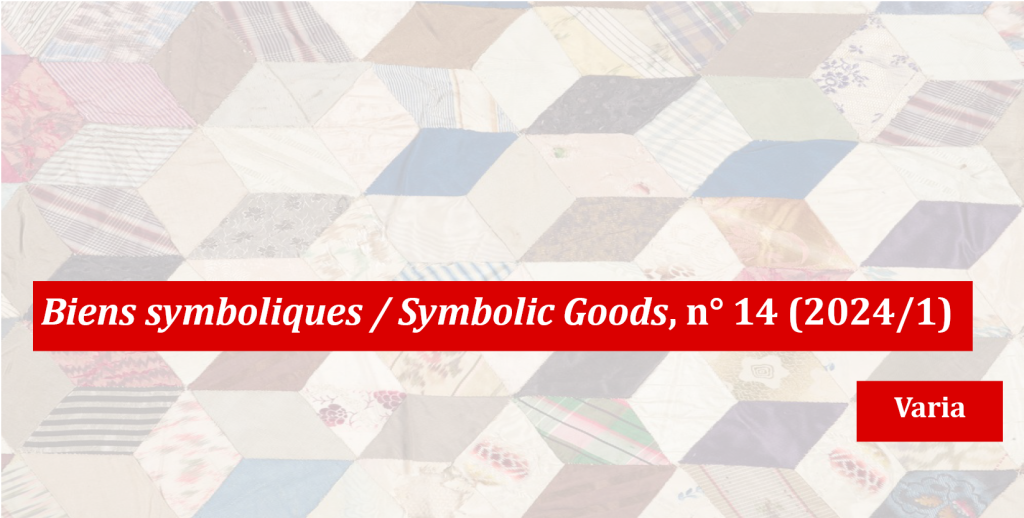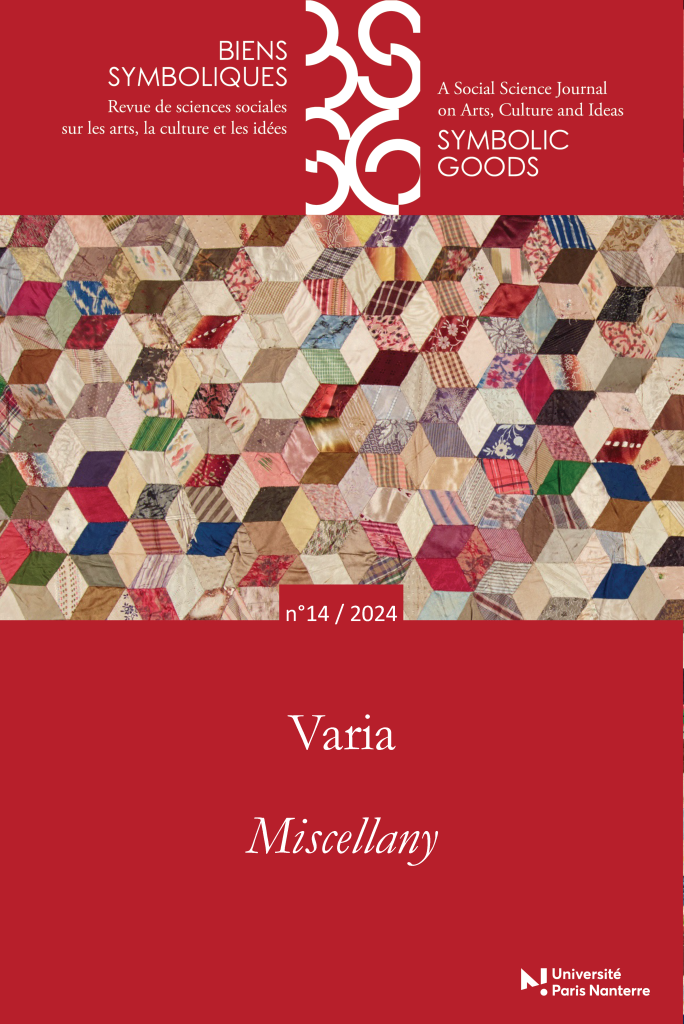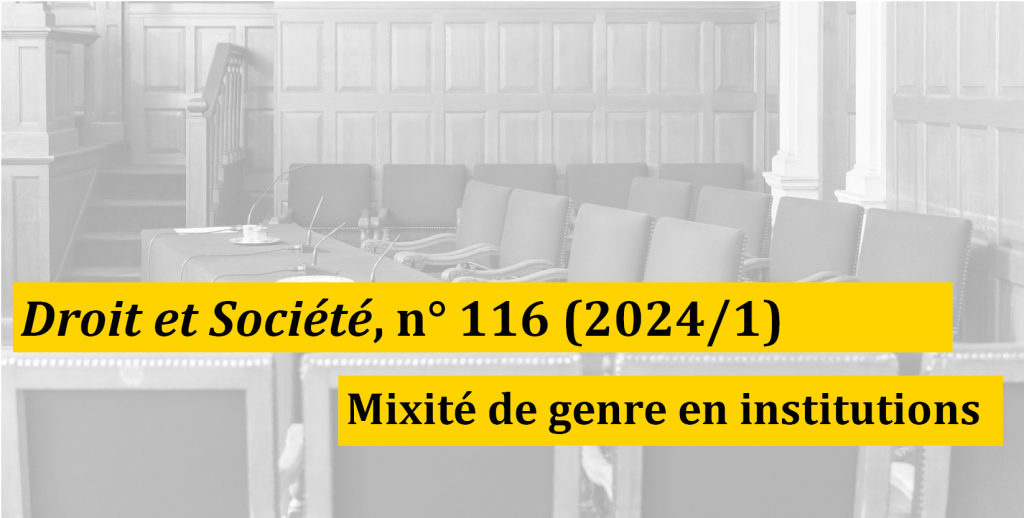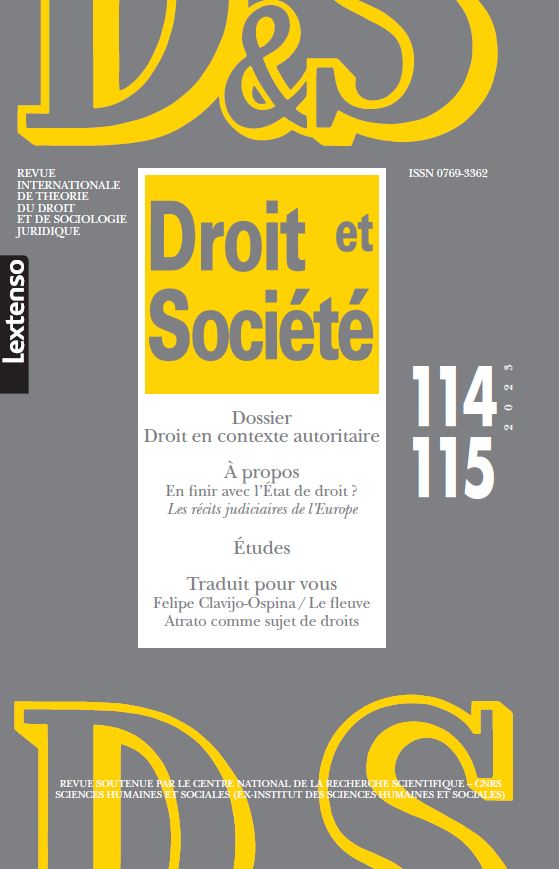Dossier coordonné par : Mehdi Arfaoui (LINC-CNIL, CEMS-EHESS), Cécile Caron (GRETS, EDF Lab), Vincent-Arnaud Chappe (CNRS, CEMS-EHESS), Olivier Guillaume (PRINTEMPS-UVSQ, FOH, EDF Lab)
Mots-clés : protection de la vie privée, numérisation, nouvelles frontières de la vie privée, privacy, intimité, gouvernance des données, Informatique et Libertés, RGPD, professionnels de la vie privée, vie privée au travail.
Les transformations du travail redessinent les frontières de la vie privée. Cette dernière est d’abord fortement régulée dans le monde professionnel où les relations d’emploi sont assorties d’obligations parfois difficiles à conjuguer. En France, l’employeur ne peut par exemple pas s’immiscer dans les affaires personnelles de ses salariés, mais dispose d’un droit de surveillance, encadré et limité, à des fins de contrôle et de protection ; tandis que l’intimité et les activités privées des salariés ne doivent empêcher ni la bonne exécution du travail ni porter préjudice à l’employeur, tout en devant être prises en considération lorsque celles-ci améliorent la qualité de vie au travail. Dans le même temps, la vie privée au travail est façonnée par une organisation et ses contraintes, des cultures professionnelles ou encore des dimensions spatiales et informationnelles. Ces contextes de travail, nécessairement situés et en constante mutation, transforment la place et le sens même donné à la vie privée.
Cet appel à articles de la revue terrains et travaux propose d’interroger la définition et les évolutions de la vie privée au travail selon des prismes variés, permettant d’embrasser à la fois la question des frontières entre espace professionnel et privé, les tensions entre l’accroissement des capacités de surveillance et la préservation de l’intimité au travail, et enfin les transformations des usages et modalités de protection de la vie privée.
Cette approche plurielle invite à explorer un ensemble de dimensions. Tout d’abord, la fluidification et la dispersion des espaces et temps de travail jouent un rôle important dans la redéfinition des représentations et des frontières du privé. Les travailleurs et travailleuses doivent effectuer une plus grande diversité de tâches, dans des lieux dispersés, des espaces reconfigurés et selon des temporalités plus larges dans des collectifs de travail profondément remaniés. Ces évolutions pourront être étudiées à partir d’univers professionnels et métiers variés embrassant par exemple les mondes des cadres, les métiers ouvriers et industriels, les services et le monde du care, l’artisanat, l’agriculture, ou encore les professions de santé. Une attention particulière pourra être accordée aux outils techniques qui modèlent ces changements, ainsi qu’aux modèles économiques qui accompagnent ces outils, plaçant souvent la vie privée et les données personnelles au cœur de leur fonctionnement. Ces évolutions se traduisent différemment selon la position des travailleurs et travailleuses et l’ancrage social des individus et des collectifs. À cet égard, il conviendra d’interroger les effets de marqueurs à l’intersection du genre, de la classe et de la « race » des acteurs et actrices concerné·es et de saisir leurs liens avec les enjeux de vie privée. Enfin, dans un contexte où les enjeux de confidentialité sont de plus en plus débattus, le droit et les autorités de régulation jouent un rôle pivot dans l’établissement de normes et de réglementations destinées à encadrer la protection de la vie privée qu’il conviendra de saisir dans sa complexité.
Les articles pourront s’inscrire dans différentes disciplines issues des sciences humaines et sociales (sociologie, ergonomie, psychologie du travail, science politique, histoire, sciences de l’information et de la communication, sciences de gestion, économie, philosophie, droit, etc.) et mobiliser des cadres théoriques variés. Les contributions devront s’appuyer sur des enquêtes de terrain ou l’analyse de corpus ou de bases de données.
Cet appel se structure autour de trois axes non exclusifs et non exhaustifs visant à explorer les contours des liens entre travail et vie privée, préservant à dessein une acception large de cette dernière.
- Articulation et interpénétration de la vie privée et de la vie professionnelle
Cet axe se propose d’interroger l’articulation et les formes d’interpénétration entre vie privée et espaces domestiques d’une part, et vie et espaces professionnels d’autre part.
Depuis leur fondation, les sciences sociales du travail se sont penchées sur l’articulation entre la sphère professionnelle et celle du hors travail. A contrario d’une tendance séculaire et inaboutie à la différenciation de ces sphères, les dernières décennies ont vu un brouillage des frontières, amplifié notamment par la reconfiguration des temporalités et des espaces de travail, et la numérisation de certaines tâches ou formes de communication. Selon les univers de travail étudiés, des formes d’interpénétration de la vie privée et de la vie professionnelle spécifiques (ré)apparaissent. Elles recouvrent de nouvelles formes d’assignation au travail via la démultiplication de sollicitations professionnelles hors des espaces et temps de travail. Elles offrent aussi la possibilité de tramer ses activités professionnelles d’activités relevant de la vie privée ; voire de mobiliser de façon instrumentale des pans de cette dernière comme appui à la construction de son activité professionnelle.
Parallèlement, l’effritement de la relation salariale a banalisé l’idée d’un travail sans ou « à-côté » de l’espace professionnel. Alors que dans certaines situations, ces possibilités offertes constituent une voie de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, elles sont également susceptibles de renforcer des inégalités, notamment de genre, dans la répartition des tâches ménagères, professionnelles et de la charge émotionnelle au sein des familles.
Quelles sont les dynamiques d’évolution des agencements entre travail et vie privée, et avec quelles conséquences sur la redéfinition de ces deux sphères ? Dans quelle mesure ces processus participent-ils à redessiner les inégalités entre groupes sociaux ? Comment évoluent, au regard de ces transformations, les normes sociales entourant la vie privée ?
- Contrôle et surveillance : recompositions et résistances de la vie privée au travail
La deuxième entrée retenue est celle de l’exercice d’une intimité au travail, en lien avec les formes de surveillance et de contrôle au travail, et les résistances que ces dernières induisent.
L’étude des activités de contrôle et de surveillance au travail fait partie des champs de recherche qui ont animé l’approche du travail par les sciences humaines depuis le début du XXe siècle. Une variété de modalités organisationnelles et d’outils techniques augmentent les possibilités de contrôle sur les temps, les déplacements ou le respect des procédures et encouragent la rationalisation de l’organisation du travail dans un rapport souvent asymétrique entre employés et employeurs. Chaque innovation réactive des formes de confrontation entre autonomie professionnelle, rationalisation organisationnelle et contrôle du travail qui s’appliquent différemment selon les groupes professionnels et les catégories socioéconomiques. La mondialisation et la délocalisation des emplois, ainsi que le développement du télétravail ont également contribué à l’intensification de la surveillance au travail, les entreprises cherchant à surveiller leurs employés à distance.
De ce point de vue, la vie privée au travail est susceptible d’apporter une certaine efficacité au travail, se rendant parfois indispensable à la bonne réalisation des activités. Pourtant, les transformations des espaces, des modes et des outils de travail diminuent les possibilités de zones « intermédiaires » où se produisent les échanges hybrides (intimes et professionnels) au sein de cercles restreints d’individus. Les motivations qui poussent les encadrants ou décideurs à vouloir réduire ou maîtriser la vie privée au travail semblent ainsi contrevenir parfois aux intérêts objectifs de l’organisation.
Ces transformations donnent parallèlement à voir des formes de résistance au contrôle et à la surveillance. Les employés peuvent être amenés à contourner les systèmes de surveillance mis en place par leur employeur (simulation de présence, pseudonymes, effacement des historiques de navigation) tandis que les syndicats peuvent négocier des accords collectifs et mener des campagnes de sensibilisation pour limiter les pratiques de surveillance. Internet peut parfois directement devenir un support pour faire émerger des collectifs « en ligne » où se construisent des relations, des savoirs, ou des mobilisations pour faire face à ces nouvelles formes de contrôle.
Dans quelle mesure les transformations du travail s’accompagnent-elles d’une évolution des formes de surveillance et de contrôle, qui affectent les manifestations de la vie privée et de l’intimité au travail ? Ces recompositions modifient-elles les manières dont s’élaborent les solidarités professionnelles et les formes de résistances face à la surveillance ?
- Régulation et professionnalisation de la protection de la vie privée
Cette dernière perspective propose d’étudier la manière dont ces transformations interagissent avec l’évolution des régulations institutionnelles des mondes du travail. Les risques que la surveillance fait peser sur la vie privée des individus ont suscité, notamment en Europe, des réponses réglementaires et législatives tentant d’encadrer les effets de la numérisation de la sphère marchande, de la recherche de sécurité publique mais également des pratiques individuelles de divulgation d’informations. Les réglementations qui ont émergé dans ce contexte ont rabattu les questions de protection de la vie privée sur la question de la gestion des données personnelles. Dans ce domaine, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur en mai 2018 a introduit un profond remaniement du cadre réglementaire renforçant les transformations à l’œuvre. La mise en œuvre de ce cadre a contribué à étendre la création de métiers et de fonctions dédiés à la protection de la vie privée (régulateur, délégués à la protection des données, responsables sécurité des systèmes d’information, correspondants informatiques et libertés, juristes spécialisés, etc.), mais aussi à faire émerger un travail des représentants de la société civile. Le renforcement les droits des personnes, notamment sur leurs données à caractère personnel a également donné à l’usager un rôle dans l’application de ces législations, ouvrant des espaces de confrontation et/ou de coopération avec les professionnels, posant la question de l’inégale propension des individus à faire l’exercice de leurs droits en fonction de leur propriété sociale. La gestion de la protection de la vie privée se répartit à la fois sur les usagers et sur un ensemble de métiers, et exigeant de ce fait des collaborations pour être mise en œuvre. Au-delà de l’émergence de nouveaux professionnels de la vie privée, ce sont également les infrastructures techniques encadrant la gestion de vie privée qui se raffinent et engendrent des transformations dans l’application du droit.
À côté du renforcement de ce droit protecteur, d’autres dimensions régulatrices – potentiellement contradictoires – sont à mettre en exergue. Le droit de la non-discrimination protège ainsi dans une certaine mesure l’expression ou l’affirmation de certaines caractéristiques qui se trouvaient auparavant confinées dans la sphère privée. Plus encore, les politiques d’égalité et de non-discrimination peuvent justifier la prise en considération par les organisations du travail de caractéristiques personnelles, à des fins d’aménagement des postes de travail et d’inclusion. Elles conduisent alors parfois à produire des dilemmes individuels ou collectifs, comme dans le cas de salarié.es se posant la question de la divulgation de leur handicap.
Quels appuis les nouvelles régulations offrent-elles aux travailleurs pour la protection de leur vie privée et avec quelles inégalités dans la capacité de s’en saisir ? En quoi la professionnalisation des métiers de la protection de la vie privée participe-t-elle aux mutations du travail ? Comment encadre-t-elle les développements technologiques et les déplacements des frontières privé/public ? Comment s’opèrent les coopérations entre professionnels et usagers autour de l’application du droit à la vie privée et quelles infrastructures techniques permettent-elles de le déployer ? Quelles articulations de ces régulations avec d’autres normes juridiques ou organisationnelles observe-t-on ?