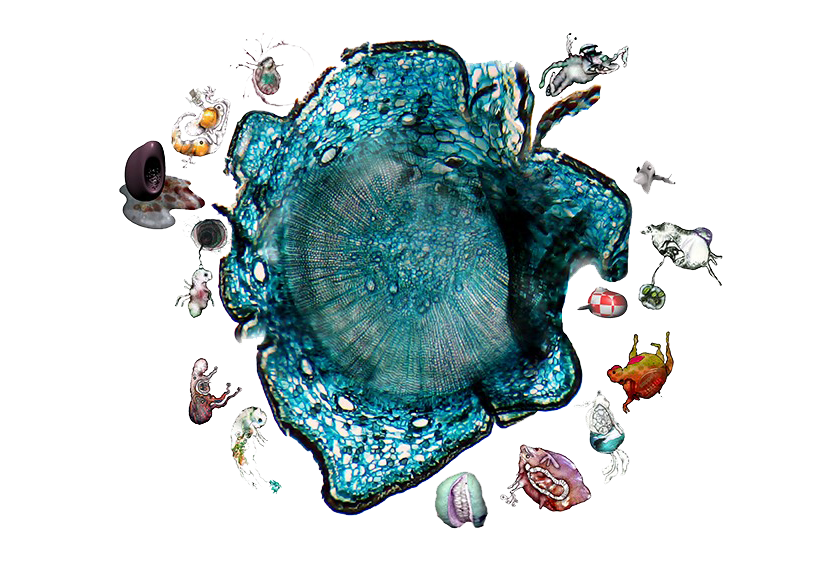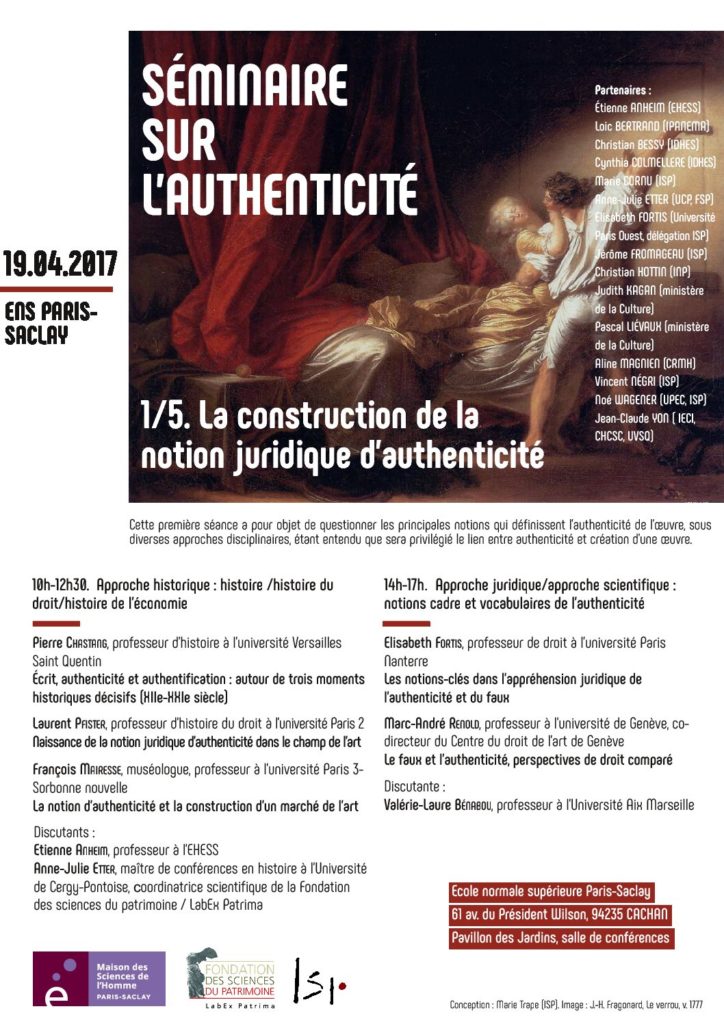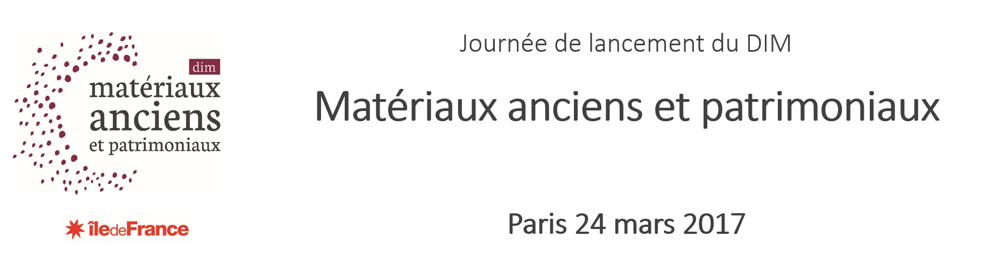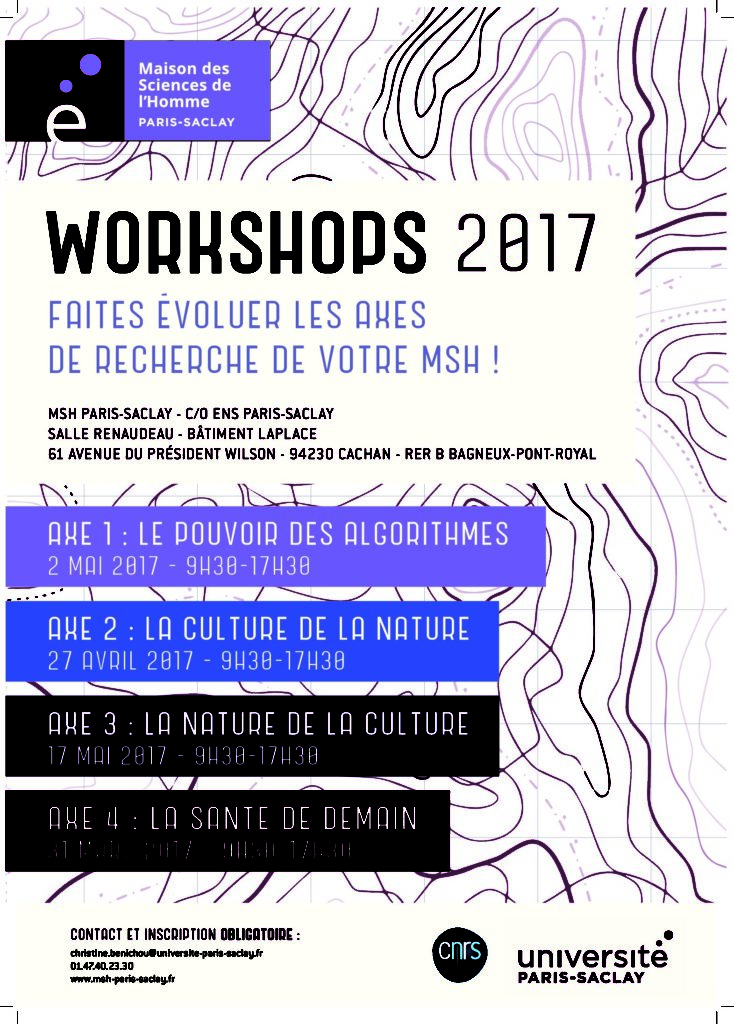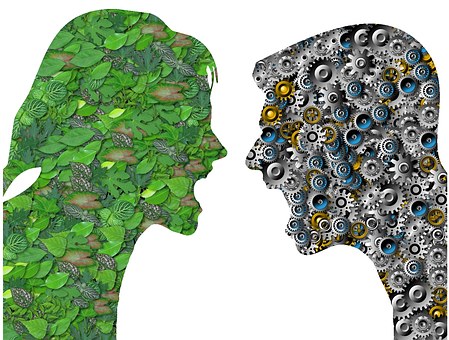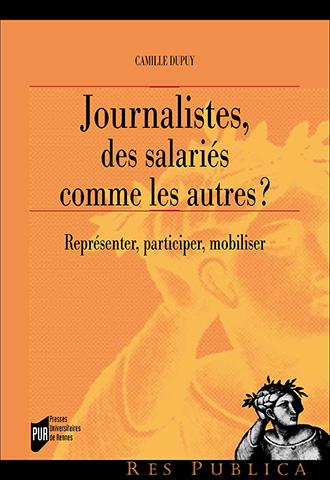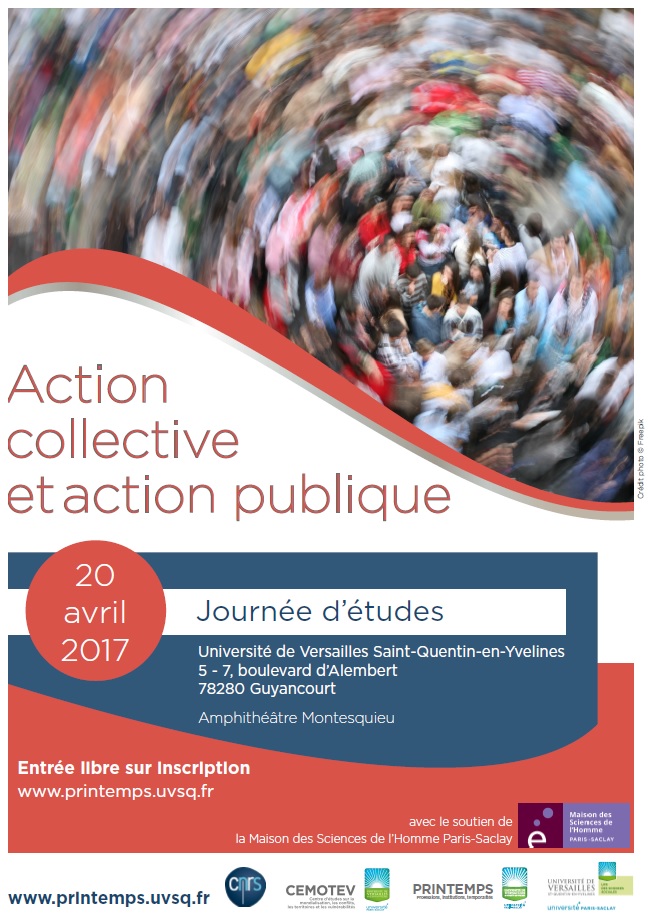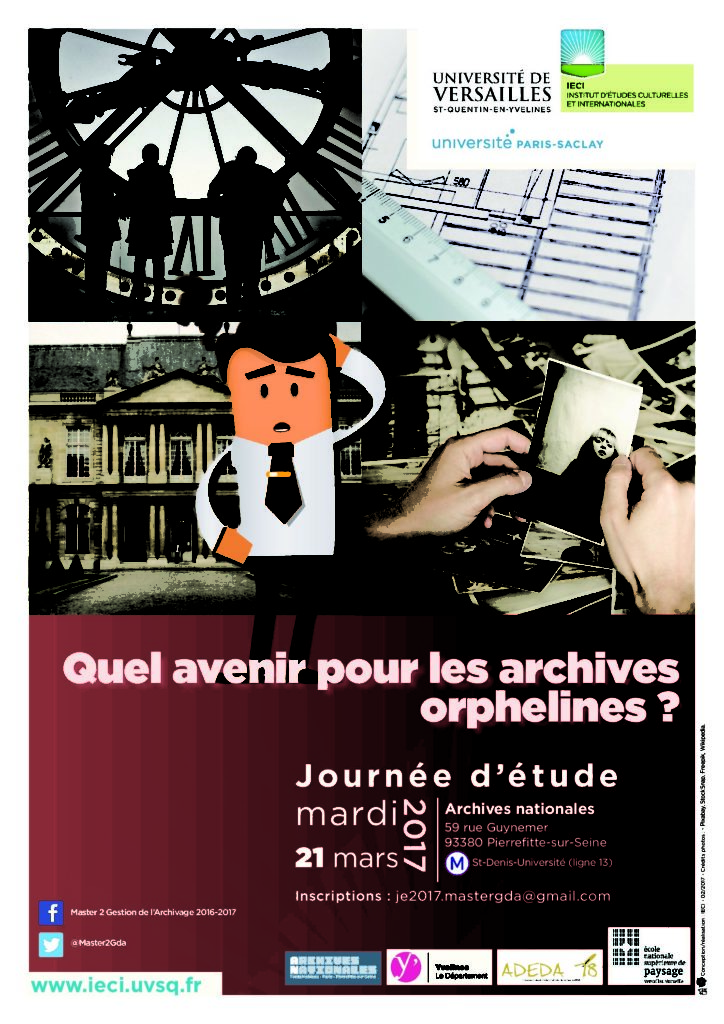La question des politiques publiques a longtemps été abordée principalement sous l’angle de l’offre par les décideurs, dans le prolongement du modèle weberien du commandement et du contrôle par l’Etat, dans une logique descendante. Depuis le début des années 1990, dans la logique des travaux sur la gouvernance, la question a évolué pour permettre la prise en compte de l’interaction de cette offre avec la demande des différents acteurs, à des échelles territoriales diverses, et pour l’ensemble du processus de politiques publiques (de la construction des problèmes à la mise en œuvre). Cette transformation a également été analysée en termes d’évolution des politiques publiques vers des actions publiques moins inscrites dans un programme piloté et défini par l’État.
Cette journée d’études vise à renouveler ces questionnements, en se centrant sur l’analyse du rôle de l’action collective et de la participation dans les processus de politiques publiques et de choix collectifs, en mobilisant les apports croisés de chercheurs en sociologie, économie, géographie, science politique… ce qui devra permettre aussi de clarifier et rendre plus riche l’aspect polysémique du terme d’action collective, utilisé à la fois pour analyser des processus de mobilisation et les modes de construction de l’action publique.
Il s’agira donc d’interroger la manière dont les demandes des acteurs collectifs, dans différents contextes institutionnels, organisés ou non, sont exprimées, formulées, négociées ; dont elles sont plus ou moins prises en compte dans la mise en œuvre des politiques publiques et, également, dans le contrôle de leurs résultats et leur évaluation –soit, autant de mécanismes attendus dans les pays démocratiques mais dont il pourra être intéressant aussi d’observer les formes possibles dans les pays non démocratiques.
Sans nier l’importance des processus partant du sommet de l’Etat ou des institutions supra étatiques (top down), il s’agit donc d’explorer la diversité des processus par lesquels des mobilisations se développent (bottom up), en questionnant ses effets réels et symboliques sur le contenu et le déroulement de l’action publique, dans divers contextes institutionnels, économiques et politiques. Il ne s’agit donc pas tant d’analyser les processus électoraux que les formes d’organisation et de mobilisation des acteurs, qu’elles soient structurées par les groupes de pression, auto-organisées, éphémères, durables ; et, qu’elles utilisent les outils reconnus de la participation, ou se situent en dehors des dispositifs institutionnalisés. De plus, si l’angle choisi invite à développer des réflexions sur les échelles infranationales, et les acteurs non étatiques dans les politiques publiques, les autres échelles de territoire et tous les types d’acteurs.
La réflexion sera structurée autour de trois thèmes, avec des interventions davantage ciblées sur un thème et une question transversale, posée de manière plus générale.
Premier thème : Les choix collectifs
En amont des politiques publiques, les contributions au colloque pourront porter sur les formes de persuasion, de mobilisation, de négociation, ainsi que sur les ressources mobilisées par les acteurs de l’action collective pour intervenir et participer aux processus de choix collectifs, de décisions et de mise en cohérence politique, afin de produire des actions publiques. Comment les choix collectifs émergent-ils ? Dans quelle mesure relèvent-ils de la démocratie, de quelle forme de démocratie ? Qu’en est-il dans les pays non démocratiques ?
Deuxième thème : La mise en œuvre, les processus
Les politiques publiques se mettent en œuvre dans un contexte de rapports de force, de négociations dans lesquelles l’action collective est partie prenante, à côté des décideurs, mais aussi des bureaucrates et des professionnels de l’action publique. Dans quelle mesure l’action collective influence-t-elle le déroulement voire le contenu de l’action publique, comment vient-elle la légitimer, la transformer ou la combattre ?
Troisième thème : L’évaluation, le rôle des chiffres et des indicateurs
Le discours politique et institutionnel actuel met en avant les dispositifs de contrôle et les procédures d’évaluation par les acteurs concernés. Comment et jusqu’à quel point les instruments et les outils d’évaluation prennent-ils en compte leurs attentes, leurs motivations, leurs intérêts ? Quels sont les effets concrets des évaluations participatives et leurs limites ?
Question transversale : Echelle et développement territorial
Le colloque interroge donc les différents « lieux de la décision » mais aussi l’émergence des territoires comme des acteurs des politiques publiques. Les contributions pourront ainsi se situer à un niveau multiscalaire, supra et infranational, pour analyser la montée en responsabilités de nouveaux acteurs et leurs articulations, leurs synergies, leurs difficultés, voire leurs blocages.
Programme (téléchargez le programme : programme-20-04-17)
9h : Accueil des participants
9h30 : Introduction
Laurent Willemez (directeur du laboratoire Printemps) et Jean Cartier-Bresson (directeur du laboratoire Cemotev)
9h45 à 11h30 : Table ronde « Les choix collectifs » animée par Jean Cartier-Bresson, économiste
Stefano Palombarini, maître de conférences en science économique, Université Paris 8, LED, « Election, crise politique et évolution du modèle socio-économique français »
Cécile Blatrix, professeure de science politique, AgroParisTech, CESSP, « Débat public, action collective et légitimité des décisions publiques. Le cas des Grands Projets Inutiles et Imposés » (GPII)
Caroline Chapain, Lecturer, Business School, University of Birmingham, « Quelles politiques pour les villes créatives ? »
Maxime Quijoux, chargé de recherche en sociologie, Printemps, UVSQ/CNRS, « Quand les ouvriers se saisissent des élus: le cas d’une reprise d’entreprise en SCOP en région parisienne »
Pause
11h45 à 13h : Table ronde « La mise en œuvre, les processus » animée par Maryse Bresson, sociologue
Charlotte Halpern, chargée de recherche, Sciences Po, Centre d’études européenne, « Participation et changement dans les politiques publiques »
Nathalie Pottier, maître de conférences en géographie, Cemotev, UVSQ, « L’action collaborative en appui à l’action publique : un défi lancé à la métropole parisienne pour la résilience urbaine et la gestion de crise inondation»
Matthieu Hely, professeur de sociologie, Printemps, UVSQ, « Les entreprises de l’économie sociale et solidaire sont-elles des entreprises ‘comme les autres’ ? Retour sur la loi relative à l’économie sociale et solidaire de 2014 et sa mise en œuvre »
Repas
14h15 à 15h30 : Table ronde « L’évaluation, le rôle des chiffres et des indicateurs » animée par Patrick Hassenteufel
Patrice Duran, professeur de sociologie, ENS Cachan, « Les limites de l’évaluation participative. L’exemple français »
Charlotte Boisteau, consultante en économie et politique de développement « La gouvernance de l’évaluation »
Jean Cartier-Bresson, professeur de science économique, Cemotev, UVSQ, « L’action collective et la gouvernance par le nombre ou par les nombres »
Pause
15h45 à 17h : Table ronde « Echelles et développement territorial » animée par Dalila Messaoudi, Géographe
André Torre, directeur de recherche en économie, INRA-Agroparistech, UMR SAD-APT, « Les moteurs du développement territorial »
Lilian Loubet, maître de conférences en Aménagement de l’espace et Urbanisme, Université du Havre, UMR IDEES-CIRTAI, « Recompositions des territoires et participation à la décision : l’exemple de la coopération intercommunale »
Maryse Bresson, professeure de sociologie, Printemps, UVSQ, « Les défis de la participation locale face aux recompositions du ‘central’ : l’exemple des politiques sociales territoriales»
17h : Conclusion de la journée
Patrick Hassenteufel, professeur de science politique, Printemps, UVSQ
Informations pratiques
Date : 20/04/2017 – 9h-17h30
Lieu : Amphithéâtre Montesquieu
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
5 – 7, boulevard d’Alembert
78280 Guyancourt
Inscription libre mais obligatoire : cliquez ici