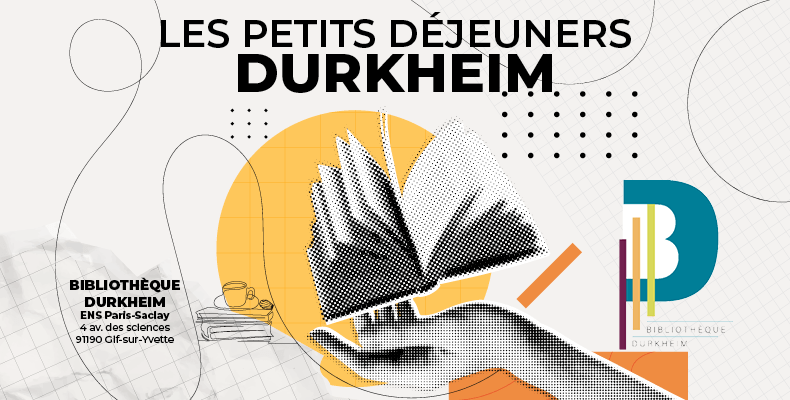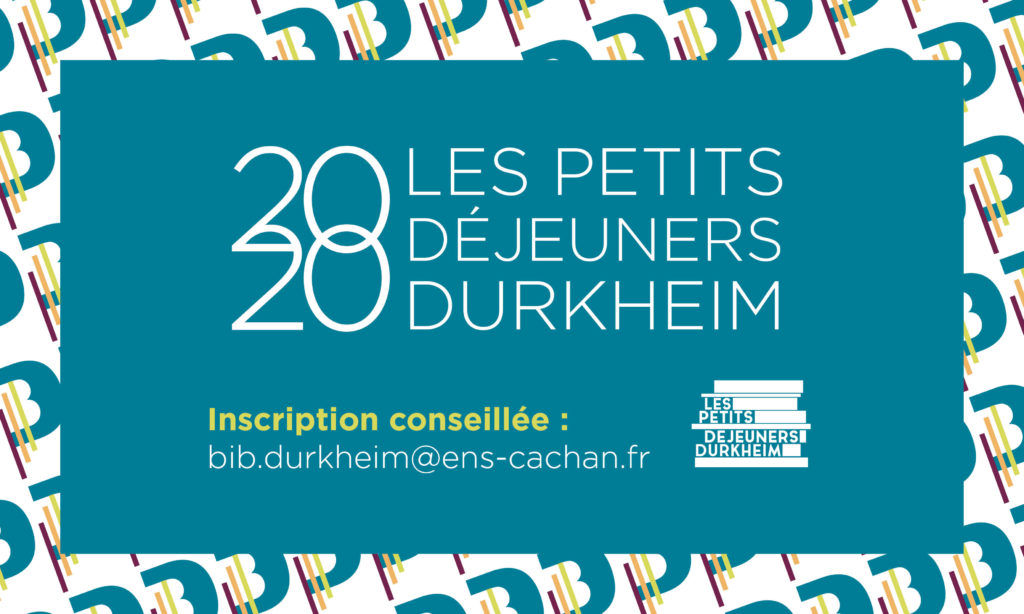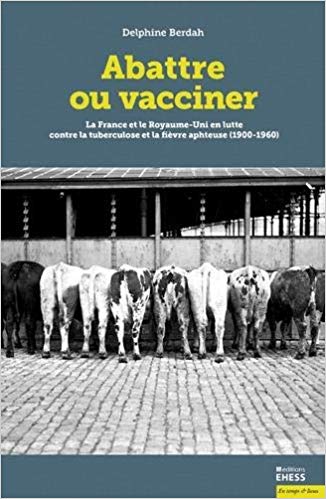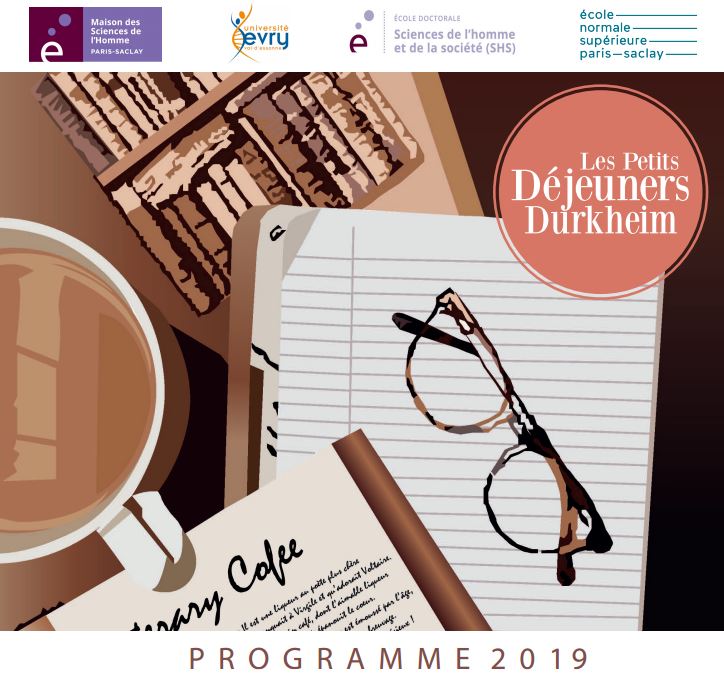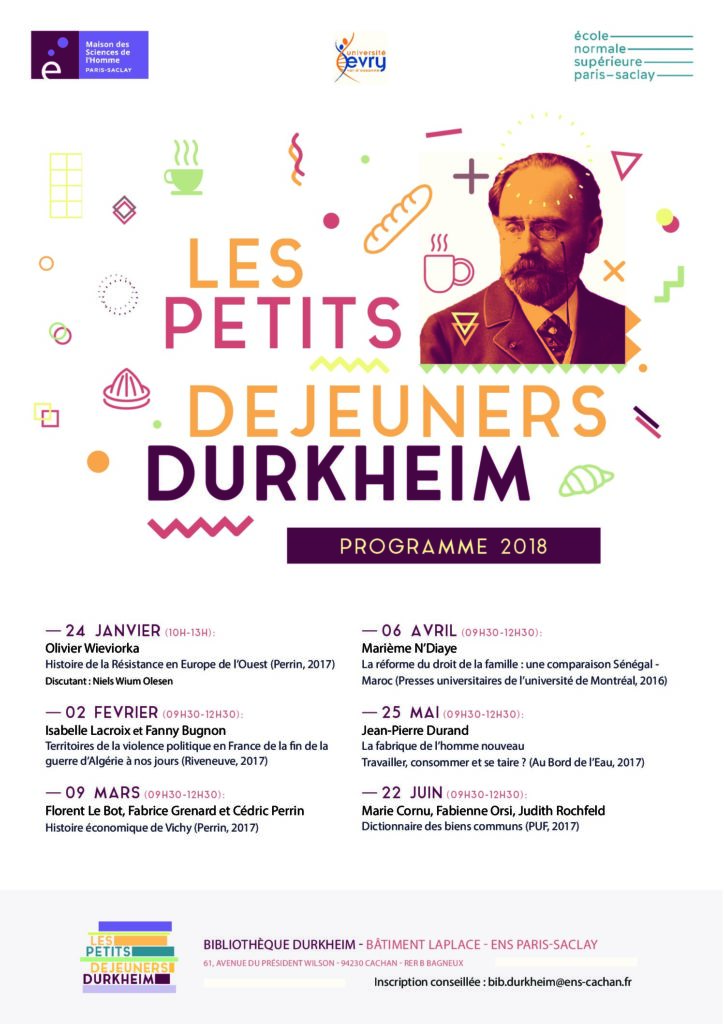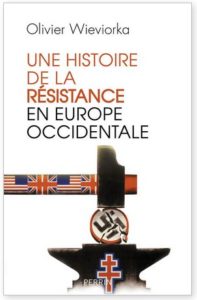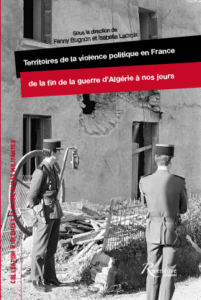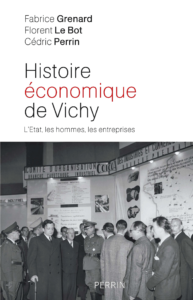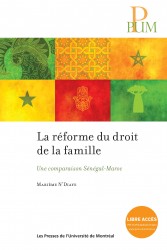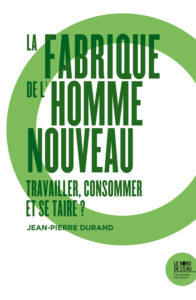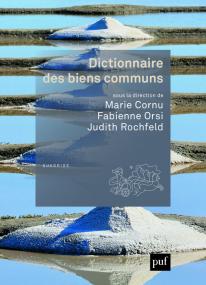Petits déjeuners Durkheim
saison 2024-2025
Les Petits Déjeuners Durkheim 2024-2025
La MSH Paris-Saclay, les laboratoires CEPS, IDHES et ISP de l’ENS Paris Saclay vous invitent à une nouvelle saison des Petits Déjeuners Durkheim.
Autour d’un café à la bibliothèque Durkheim, chercheurs, enseignants, étudiants et tout public intéressé sont conviés à débattre suite à la présentation d’ouvrages issus de travaux en Sciences Humaines et Sociales.
Pour information : Les doctorants venus assister en présentiel aux présentations peuvent créditer des heures de formations dans le cadre de l’École doctorale. L’attestation est à demander à l’adresse suivante : elsa.bansard@ens-paris-saclay.fr et à déposer ensuite sur l’ADUM
Un jeudi par mois, de 10h à 11h30, voici le programme que nous vous proposons :
21 novembre
Christian Bessy Expropriation by law, Février 2024, Editeur : Edward Elgar Publishing, p204, ISBN: 978 1 03532 614 3
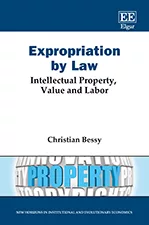
Résumé : Placing himself at the crossroads of economics, law, and sociology, Christian Bessy investigates the contemporary transformation of intellectual property rights (IPR) with the emergence of new conventions for their valuation. He demonstrates how entities previously considered inappropriate have now become the object of property rights by means of a creeping legal codification and generate inequalities.
Discutant : Thomas Vendryes (CEPS, Université Paris Saclay
Evénement également disponible à distance : https://ens-paris-saclay-fr.zoom.us/j/97127415350?pwd=lyL53abhL4XF1eS0au98RZe4s8eHcl.1
ID de réunion: 971 2741 5350
Code secret: 50511035
19 décembre
Deux ouvrages de chroniques seront ici l’objet des échanges :
Baptiste Coulmont et Pierre Mercklé, Pourquoi les top-modèles ne sourient pas, Chroniques sociologiques, Paris, Presses des Mines, parution le 19 novembre 2020, 183 p, ISBN13 : 978-2-35671-619-4

Résumé : Entre 2012 et 2019, Baptiste Coulmont et Pierre Mercklé ont tenu une chronique régulière dans le journal Le Monde. Au coeur de leur démarche : rendre compte de la sociologie telle qu’elle se fait aujourd’hui. Dans le foisonnement des enquêtes, ils ont choisi les plus instructives. Celles qui nous expliquent pourquoi les top-modèles ne sourient pas, quelles sont les bonnes raisons de croire au Père Noël, comment contourner l’impôt sur la fortune, ou si la participation des hommes aux tâches ménagères est un facteur de divorce. Celles qui nous montrent comment les sociologues travaillent, avec des enquêtés qui meurent, qui mentent ou qui s’insultent. Celles qui nous rappellent que nous n’avons tous ni les mêmes ressources, ni les mêmes désirs. Rassemblées pour la première fois dans cet ouvrage, ces chroniques sociologiques traversent une décennie d’enquêtes, de grandes questions sociales et de petites énigmes sociologiques. Elles nous rappellent qu’il faut de tout pour faire le monde social tel qu’il est. Et elles montrent comment les sciences sociales peuvent aider, avec les armes et les outils de l’enquête, à mieux comprendre la société, dans toute sa diversité et toute sa complexité.
Frédéric Lebaron Savoir et agir. Chroniques de conjoncture (2007-2020), Vulaines sur Seine, Editeur : Editions du croquant, parution le 12 janvier 202, 338p, ISBN : 978-2-36512-255-9

Résumé : En juin 2007, la France s’engage sur la voie d’une nouvelle « révolution libérale » sous l’égide de Nicolas Sarkozy. L’Europe ambitionne alors de devenir rapidement « l’économie la plus dynamique et la plus compétitive du monde ». L’auteur, à travers ses éditoriaux de la revue Savoir/Agir, a tenu la chronique des conjonctures économiques et politiques qui ont caractérisé au fil des jours cette période de bouleversements, dont il propose une lecture à la fois sociologique et engagée.
A compter de cette séance, le Lumen organisera une « bibliothèque éphémère » en présentant et proposant à l’emprunt d’autres ouvrages en lien avec les ouvrages discutés. Les emprunts seront facilités.
23 janvier
Laurence Maurines et Christian Bracco Apprendre et penser les sciences dans l’enseignement et la formation scientifique. Vers une interdisciplinarité didactique-histoire des sciences-épistémologie, Gif-sur-Yvette, MSH Paris-Saclay Éditions, Université Paris-Saclay, novembre 2024, 232 p.

Résumé : Le monde contemporain doit relever de nombreux défis qui nécessitent un regain d’intérêt pour les métiers scientifiques, en particulier de la part des femmes. Ils requièrent également l’acquisition, par tout citoyen, d’une culture scientifique qui lui permette de penser et d’agir dans des contextes variés. Parmi les leviers envisagés pour l’enseignement des sciences par les textes ministériels français relatifs aux réformes de ces vingt dernières années figure l’introduction de l’histoire des sciences et d’éléments de nature épistémologique. Les attendus institutionnels de cette introduction restent peu explicités et opérationnalisés. Ce volume vise à participer au développement, en France, de travaux sur l’introduction de l’histoire des sciences et de l’épistémologie dans l’enseignement et la formation scientifique (amplement documentés à l’étranger), tout en apportant un regard critique. Il discute des enjeux éducatifs et sociétaux de cette introduction et des questions qu’elle soulève quant aux objectifs d’apprentissage à poursuivre et des stratégies à mobiliser en classe, ainsi que des méthodologies de recherche à mettre en œuvre. La réflexion est conduite dans le cadre d’un champ disciplinaire donné, la physique. Différents thèmes au programme d’enseignement du secondaire ou du début du supérieur (la vision, le principe d’inertie, le mouvement des planètes, le temps en mécanique relativiste, la dynamique des fluides) sont abordés. Divers objectifs d’apprentissage (appropriation des concepts scientifiques, raisonnement des élèves, représentations de la/des science(s), pensée critique) et deux stratégies d’enseignement (implicite et explicite) sont envisagés. Les didacticiens, historiens et épistémologues des sciences réunis ici proposent des regards croisés et complémentaires, conduisant à simplifier ou au contraire à enrichir le discours historique, selon les objectifs d’apprentissage visés. Ils montrent ainsi la fécondité d’une réflexion interdisciplinaire.
Discutant : Nicolas Décamp (LDAR, Université Paris Cité)
Séance disponible en visioconférence :
https://ens-paris-saclay-fr.zoom.us/j/98643672925?pwd=6HIbei8UnpG5wMMFTIDbVEgkFFNCIQ.1
ID de réunion: 986 4367 2925
Code secret: 40889558
« Bibliothèque éphémère » par le Lumen : présentation et proposition d’ouvrages
13 mars
Vincent Négri et Nathan Schlanger (dir.) 1941. Genèse et développements d’une loi sur l’archéologie, France, Editeur : La Documentation Française, octobre 2024, EAN 9782111576605
 Résumé : L’archéologie, par ses objectifs et ses méthodes, est une discipline singulière
Résumé : L’archéologie, par ses objectifs et ses méthodes, est une discipline singulière
au sein des sciences sociales et humaines. Si les vestiges enfouis et stratifiés
qu’ont laissés les hommes constituent la matière première de cette discipline,
la découverte et l’extraction de ces traces matérielles, même menées et
documentées aussi bien que possible, impliquent toujours leur déstructuration,
voire leur disparition, et en tout cas l’impossibilité de les fouiller à nouveau.
C’est pourquoi le droit de l’archéologie – en décalage avec les législations
protectrices des monuments historiques, des archives et des musées – articule
la production des connaissances avec des mesures de mitigation spécifiquement
conçues pour faire face à la disparition des sites et des vestiges du passé.
Dès le xix
e siècle, en amont de la loi fondatrice de 1941, les prémices de ce
droit attestent de l’émergence et de la professionnalisation de la discipline. En
aval, et notamment avec l’émergence d’un droit de l’archéologie préventive
en 2001, des processus institutionnels et scientifiques renouvelés participent
à la sauvegarde du patrimoine archéologique et à son inscription dans des
dynamiques culturelles et sociales.
En abordant aussi les influences internationales sur cette législation, ses
rapports avec les conflits armés ou encore avec l’économie de marché, les
contributeurs de ce volume retracent les enjeux institutionnels, patrimoniaux et
sociétaux qui ont façonné, et qui construisent encore, le droit de l’archéologie
Séance disponible en visioconférence :
https://ens-paris-saclay-fr.zoom.us/j/94900640101?pwd=BnAqtQxUBxuwfEoF2KdPpBXA8ZsKuJ.1
ID de réunion: 949 0064 0101
Code secret: 05941968
« Bibliothèque éphémère » par le Lumen : présentation et proposition d’ouvrages
20 mars
Olivier Wieviorka Histoire totale de la seconde guerre mondiale, Editeur : Perrin, parution 24 août 2023, 1072p, ISBN 2262079935
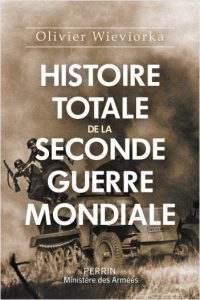
Résumé : Cet ouvrage est né d’un constat paradoxal. Si nous croulons a priori sous les livres portant sur la Seconde Guerre mondiale, il existe en réalité peu de grandes synthèses sur le sujet – et aucune de l’envergure de celle que propose Olivier Wieviorka. Fruit de nombreuses années de travail, elle innove d’abord par son approche globale qui la distingue des classiques anglo-américains qui privilégient les seules opérations militaires. Bien entendu, l’historien aborde tous les fronts : l’Europe évidemment, mais aussi l’Asie-Pacifique (si souvent négligée, en particulier la Chine), l’Afrique du Nord ou encore le Moyen-Orient. Il s’intéresse également à l’ensemble des acteurs (Canadiens, Australiens, Indiens…) et couvre tous les domaines : stratégique, comme il se doit, mais aussi idéologique, économique, logistique, diplomatique… – sans oublier l’histoire sociale et mémorielle habituellement traitée en parent pauvre. Enfin, l’auteur renouvelle largement la matière, souvent un peu datée, en intégrant les recherches les plus récentes dans une démonstration aussi rigoureuse sur le fond que limpide dans la forme.
En découle un grand récit, bien écrit et formidablement incarné, qui montre à quel point ce conflit fut véritablement mondial et total. Un ouvrage qui s’attache de concert à raconter, comprendre et expliquer en faisant sienne l’exigence formulée par Albert Camus dans L’Homme révolté : « On estimera peut-être qu’une époque qui, en cinquante ans, déracine, asservit ou tue soixante-dix millions d’êtres humains doit seulement, et d’abord, être jugée. Encore faut-il que sa culpabilité soit comprise. »
Prix du livre d’histoire contemporaine 2024
« Bibliothèque éphémère » par le Lumen : présentation et proposition d’ouvrages
Séance disponible en visioconférence : https://ens-paris-saclay-fr.zoom.us/j/98390458570?pwd=THwbYJcbEvmDA9nvdrs56gTGbHsnyE.1
ID de réunion: 983 9045 8570
Code secret: 00904603
10 avril
Reporté au 12 juin
22 mai
Michela Barbot, Les règles de la valeur. Les prix et l’estimation au prisme du droit (XVIIe-XVIIIe siècle), Presses de l’Université Toulouse Capitole, Coll. EHDIP., n. 36, 2025.
Discutant : Noé Wagener (ISP, Université Paris Saclay)
« Bibliothèque éphémère » par le Lumen : présentation et proposition d’ouvrages
Lien visio :
https://ens-paris-saclay-fr.zoom.us/j/94157243596?pwd=F1eeZmB1DENxE3ZAaYbBQyTVaqnjlp.1
ID de réunion: 941 5724 3596
Code secret: 27353493
12 juin
Intervenant Thomas Vendryes (CEPS – Université Paris-Saclay)
Trois articles en économie portant que la Chine seront discutés :
Li, Shi / Vendryes, Thomas (mimeo) : Land interests and land conflicts: An investigation of the determinants of local land institutions in rural China
Discutante : Caroline Vincensini (IDHES, Université Paris Saclay)
La séance est disponible en hybride : https://orsay.bbb.cnrs.fr/b/ban-ro0-2jl-d0g
25 septembre
Julien Gargani (dir.), Connaitre la sélection (titre provisoire), collection ACTES, à paraitre en juin 2025
En présence de trois auteurs : Guillaume Achaz (MNHN), Julien Gargani (Centre d’Alembert), Léonard Moulin (INED)
A la bibliothèque Durkheim
La bibliothèque Durkheim est consacrée aux ouvrages et revues en Sciences Humaines et Sociales. Située au 3ème étage de l’ENS, Bâtiment sud-ouest, elle vous accueille toute l’année les lundis et jeudis entre 13h et 17h, et pour les Petits Déjeuners Durkheim de 10h à 11h30 un jeudi par mois !

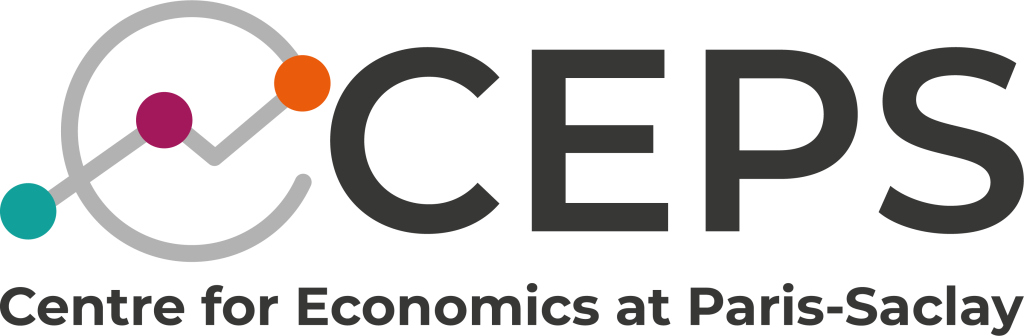

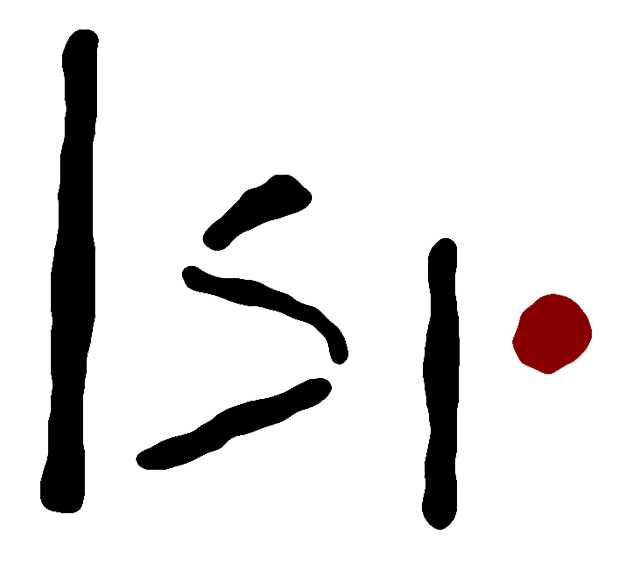
Petits déjeuners Durkheim
saison 2024-2025 Lire la suite »