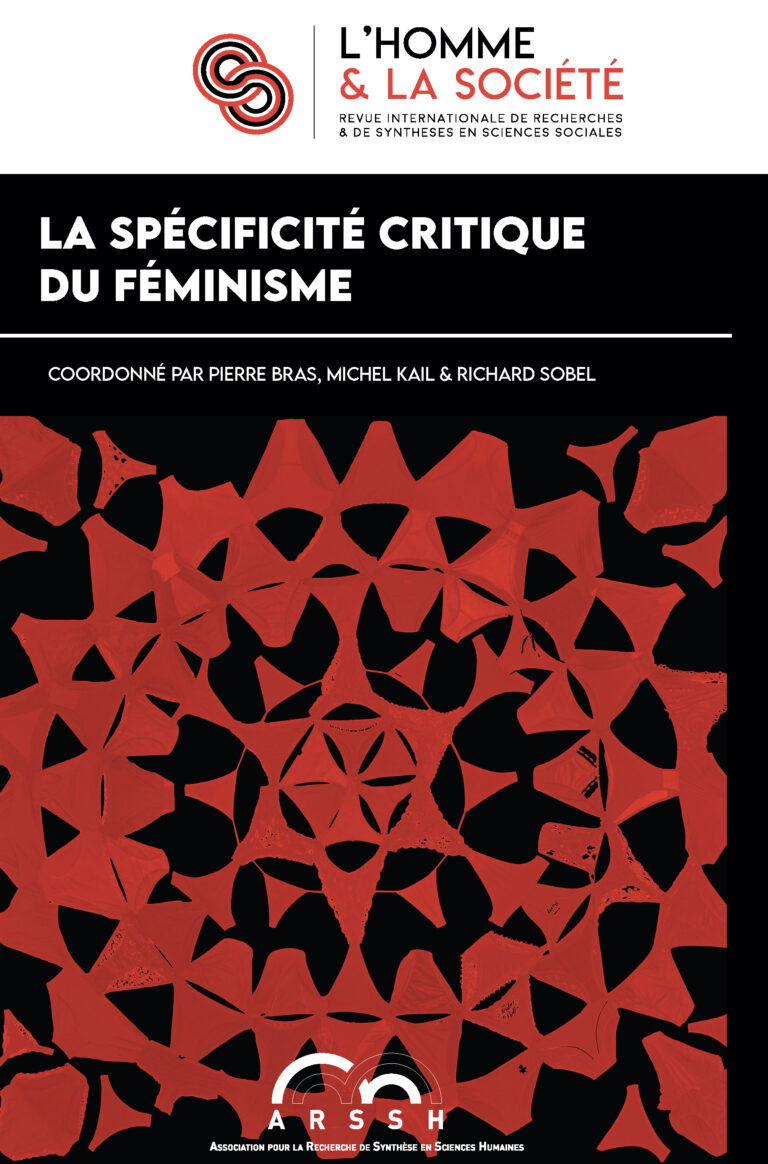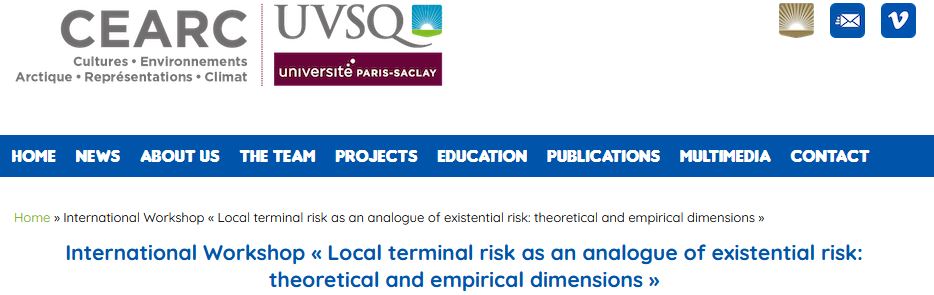Appel à contributions pour terrains & travaux : Promouvoir l’égalité au niveau local
Appel à contributions pour terrains & travaux : "Promouvoir l'égalité au niveau local"
INFORMATIONS
La revue terrains & travaux, accompagnée par la MSH Paris-Saclay, lance un appel à contributions pour son dossier thématique : « Promouvoir l’égalité au niveau local ».
Date de clôture de l’appel : 15 janvier 2026
Télécharger ici l’appel au format PDF
Présentation de l'appel
Dossier coordonné par : Anouk Flamant (Insei), Gwenaëlle Perrier (Université Sorbonne Paris Nord), Manon Torres (Dares) et Alban Jacquemart (Université Paris-Dauphine/PSL)
Que l’on songe à la décision votée en mai 2022 par le conseil municipal de Grenoble d’autoriser le port du « burkini » dans les piscines municipales ou au plan de mobilisation pour l’accueil des réfugié·es adopté par le Conseil de Paris en octobre 2015, plusieurs « controverses d’égalité »[1] ont, ces dernières années, impliquées des collectivités territoriales. Parallèlement à ces controverses, différentes politiques de promotion de l’égalité s’institutionnalisent depuis le début des années 2000 au niveau local, qu’elles concernent la lutte contre les discriminations ethno-raciales, l’accueil à destination des personnes exilées, la promotion des droits des femmes, des personnes en situation de handicap et plus rarement des minorités sexuelles et de genre. C’est l’ensemble de ces dispositifs visant à lutter contre des inégalités et des discriminations touchant différents groupes sociaux minorisés que ce dossier désigne comme des « politiques d’égalité ».
Ces sujets sont généralement constitués en champs d’étude singuliers dans l’espace académique (études de genre, Migration Studies, Queer Studies, Disability Studies, etc.) et en causes distinctes dans les espaces militants. Pourtant, ces différentes politiques ont pour principale caractéristique commune de transférer des revendications contestataires dans des espaces institutionnels. Les étudier ensemble, dans une optique comparative, permet ainsi de mieux comprendre les processus d’institutionnalisation des causes minoritaires. Ce dossier propose en particulier d’en interroger trois dimensions principales, en tenant compte de la diversité des contextes nationaux.
Des politiques locales dans un environnement multi-scalaire
La structuration de politiques locales d’égalité pourra d’abord être interrogée en prêtant attention à l’articulation entre les différentes échelles d’action publique. En fonction des contextes nationaux, ces politiques s’inscrivent dans des histoires tantôt marquées par la primauté de l’intervention étatique en matière de lutte contre les discriminations, comme ce fut le cas en France en matière de promotion des droits des femmes et de l’égalité, tantôt par celle d’actrices et acteurs locaux (collectivités territoriales, associations, etc.), à l’instar de ce qui a pu se passer outre-Rhin dans ce même secteur d’action publique. Des travaux, sur le genre et les migrations notamment, ont aussi montré le rôle des organisations internationales (Union européenne, Banque mondiale, ONU) dans la mise en place d’initiatives locales en faveur de l’égalité.
Le dossier analysera donc les positionnements des actrices et acteurs locaux par rapport à l’État et/ou aux organisations internationales, en insistant non seulement sur les éventuelles spécificités des thématiques portées dans le cadre des politiques locales d’égalité, mais aussi sur les manières dont les États et/ou les institutions internationales cadrent les possibles. Dans quelle mesure la mise à l’agenda et la mise en œuvre de politiques locales d’égalité constituent-elles des canaux de politisation alternative de ces causes (féministe, antiraciste, anti-homophobe, etc.) ? De quelle manière certaines expérimentations locales sont-elles accompagnées ou dénoncées par les pouvoirs étatiques ? Des contributions historiques pourront interroger l’engagement précoce de certain·es acteurs et actrices locales (mairies, collectivites territoriales, associations, etc.) pour favoriser la promotion de causes égalitaires, par exemple quand l’État les a délaissées. Plus largement, les contributions attentives aux circulations des acteurs et actrices, des discours et cadrages des causes, ou encore des instruments de politiques publiques mobilisés pour mener des politiques locales d’égalité sont attendues.
Les acteurs et actrices locales de l’égalité
Les politiques locales d’égalité sont directement mises en œuvre par des acteurs et actrices dans les collectivités locales, les services déconcentrés de l’État ou les établissements publics. Les contributions pourront analyser ces personnels pour saisir leurs caractéristiques, leurs trajectoires, leur inscription dans l’espace local des causes minoritaires et la manière dont elles et ils investissent leurs fonctions. Il s’agira en particulier d’analyser leurs pratiques de travail et leurs potentielles positions de « militant·es de l’intérieur ». Comment coexistent et s’articulent l’allégeance à la cause et l’allégeance à l’institution chez ces professionnel·les ? Plus largement, les contributions sont invitées à interroger les ressources et marges d’action dont ils et elles disposent : quels sont leurs budgets, leurs positions institutionnelles, leur autonomie professionnelle et leurs liens avec l’exécutif politique local ? Quelles sont les coopérations et les circulations professionnelles au sein de ces institutions ?
L’institutionnalisation des causes minoritaires au niveau local implique également toute une série d’autres actrices et acteurs : les exécutifs politiques, des services en charge d’autres politiques, les associations, les syndicats, les universités, les délégué·es du défenseur des droits, les entreprises, etc. Les contributions sont ainsi invitées à développer des analyses éclairant les configurations locales d’acteurs et d’actrices. Quelles sont les logiques de coopération, de concurrence et d’interdépendance ? Observe-t-on des circulations de personnes, de savoirs et de pratiques ? La proximité des politiques d’égalité avec les mouvements sociaux joue-t-elle en leur faveur, ou participe-t-elle au contraire à leur dévaluation ? Observe-t-on, dans un même espace local, de fortes variations selon les causes ou, au contraire, voit-on se dessiner un espace structuré des causes minoritaires ?
Les conséquences des politiques d’égalité pour leurs destinataires
L’étude comparée des politiques locales d’égalité permet également de s’intéresser aux destinataires. L’enjeu de cet axe est de saisir les conséquences de ces actions locales en faveur de l’égalité sur des individus ordinaires qui en sont la cible, mais aussi sur celles et ceux qui se positionnent comme des représentant·es collectif·ves des personnes concernées par ces discriminations.
La conception et la mise en œuvre de ces politiques supposent un travail de définition des publics visés (femmes, immigré·es, personnes LGBT+ ou handicapées, etc.). Il s’agit donc d’abord d’interroger les conséquences de la production de ces catégories sur les individus destinataires de ces politiques, mais aussi sur l’ensemble des acteurs et actrices engagées dans ces politiques. Des contributions analysant les effets des catégories mobilisées par ces politiques sont ainsi particulièrement attendues. Elles pourront s’intéresser aux expériences individuelles et collectives des personnes concernées en ayant une attention sur leurs trajectoires de vie et d’engagement, dans une perspective contemporaine et historique. Ces politiques activent-elles des pratiques attirant ou au contraire marginalisant certains publics ? L’auto-définition des individus entre-t-elle en concurrence avec les définitions institutionnelles ? À quelles conditions certaines populations peuvent-elles ou non se saisir de ces politiques en leur faveur ? Les contributions pourront aussi rendre compte des conséquences de ces initiatives locales pour les associations existante et leurs évolutions. Les potentielles hybridations entre différentes catégories de publics sont ainsi susceptibles d’agir sur les acteurs et actrices défendant une cause. Quelles tensions émergent du chevauchement des catégories de genre, de race, de classe ou de handicap dans les politiques locales ? Quelles formes de conflictualité ou de solidarité naissent de ces redéfinitions des publics ciblés ?
Cet axe conduit aussi à s’interroger sur les conséquences concrètes de l’action menée dans cet espace local de l’égalité. L’enjeu est de saisir les effets contraignants mais aussi habilitants sur les destinataires de l’action publique. Comment l’existence de politiques de lutte pour l’égalité de genre au niveau local affecte-t-elle l’expérience des militantes de la cause des femmes ? Quels sont les effets pour les personnes en situation de migration de vivre dans un territoire se revendiquant comme « accueillant » ? De quelle manière les politiques volontaristes en matière de participation des personnes en situation de handicap impactent-elles leurs trajectoires d’engagement ? Quels sont les savoirs et savoirs-faire que ces personnes acquièrent et comment les mobilisent-elles ?
[1] Juliette Rennes, « Les controverses d’égalité en droit en régime républicain », in Badie Bertrand, Déloye Yves (dir.), Le Temps de l’État, Paris, Fayard, 2007 : 408-419.
Consignes de soumission
Ce dossier réunira des articles empiriques originaux de différentes disciplines de sciences sociales. Les articles sur d’autres cas nationaux que la France sont encouragés.
Les articles de 50 000 signes maximum (espaces, notes et bibliographie compris) doivent être accompagnés de 5 mots clés et d’un résumé de 150 mots, en français et en anglais. Les articles sont attendus pour le 15 janvier 2026 et doivent être envoyés à :
- Anouk Flamant – anouk.flamant@insei.fr
- Gwenaëlle Perrier – perriergwen@yahoo.fr
- Manon Torres – manontorres4@gmail.com
- Alban Jacquemart – alban.jacquemart@dauphine.psl.eu
Les consignes relatives à la mise en forme des manuscrits sont consultables sur le site de la revue : http://tt.hypotheses.org/consignes-aux-contributeurs/mise-en-forme
terrains & travaux accueille par ailleurs des articles hors dossier thématique (50 000 signes maximum), qui doivent être envoyés à :
- Géraldine Farges – geraldine.farges@u-bourgogne.fr
- Jean-Noël Jouzel – jeannoel.jouzel@sciencespo.fr
- Maxime Quijoux – maxime.quijoux@lecnam.net
Pour plus de détails, merci de consulter le site de la revue : http://tt.hypotheses.org
Appel à contributions pour terrains & travaux : Promouvoir l’égalité au niveau local Lire la suite »