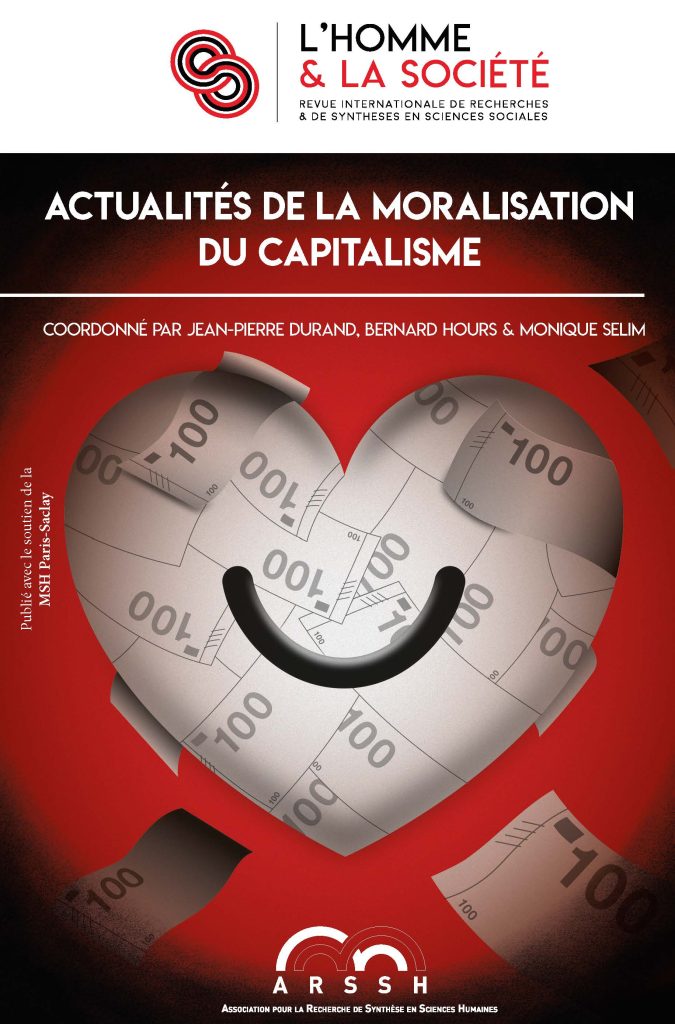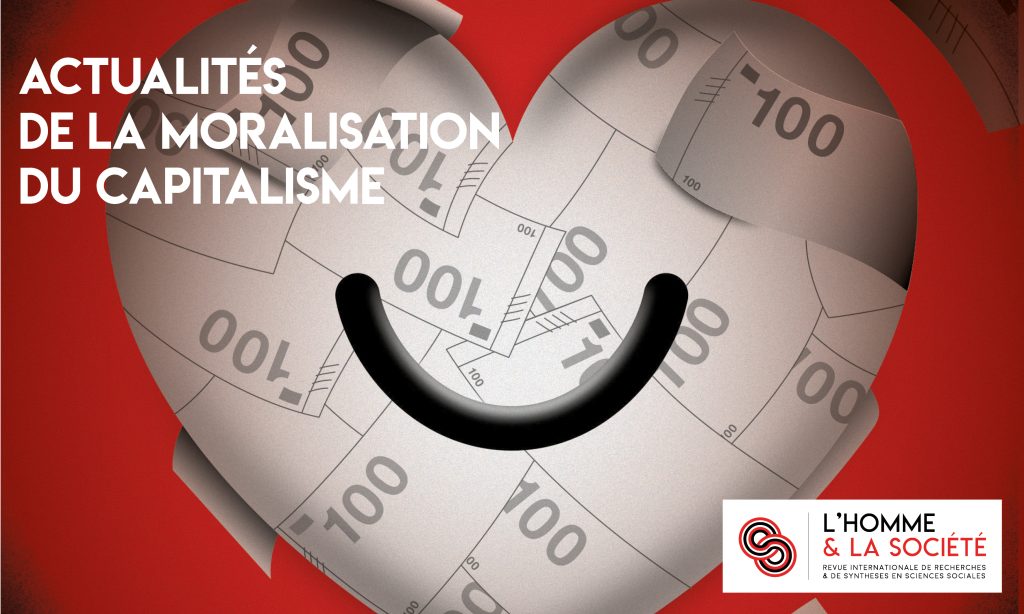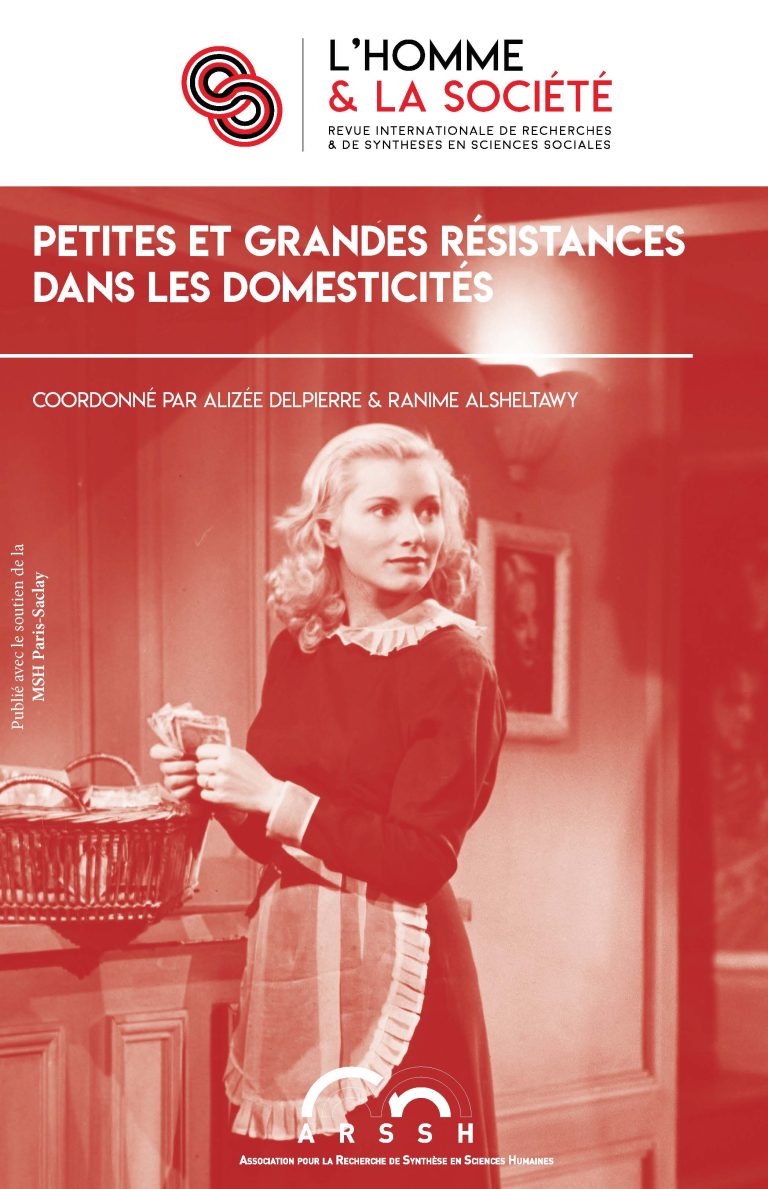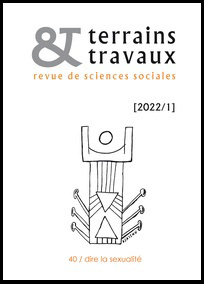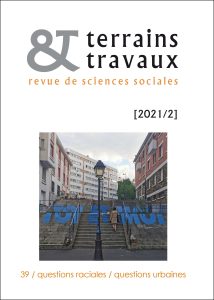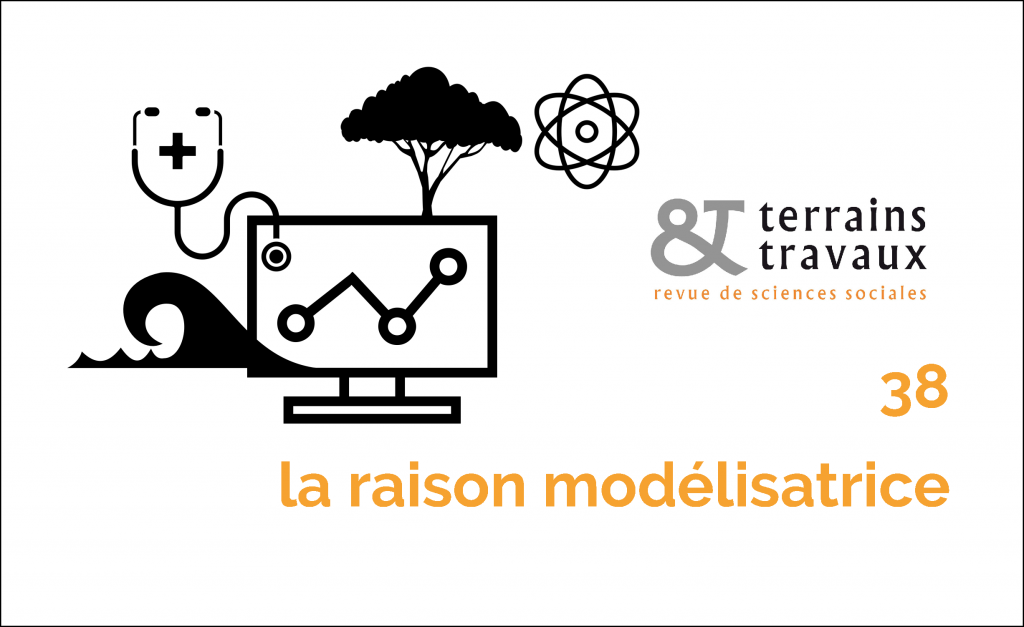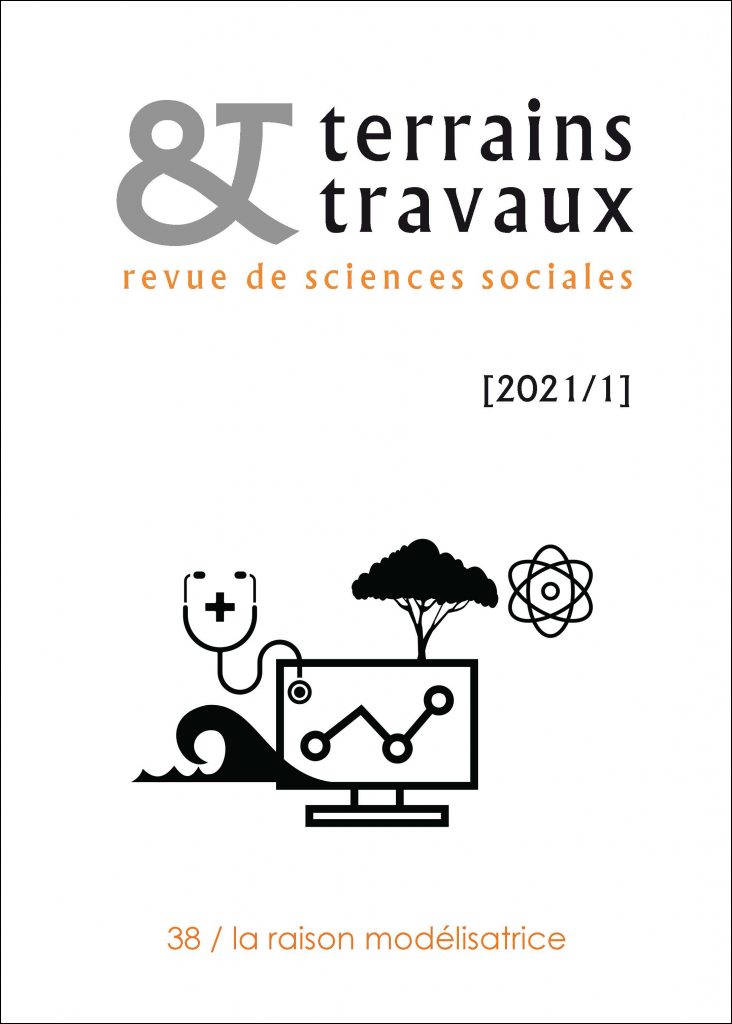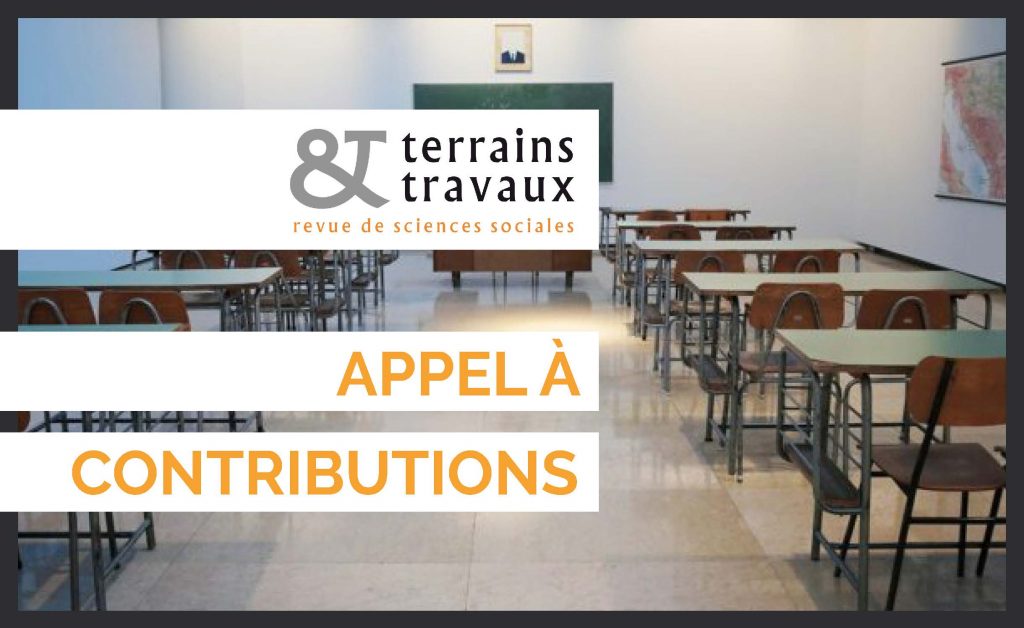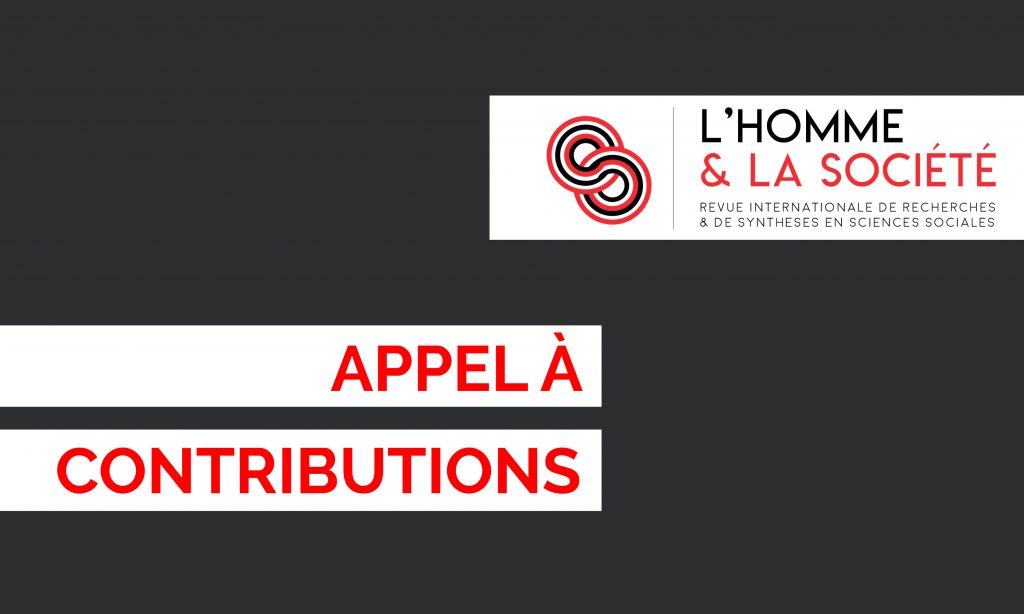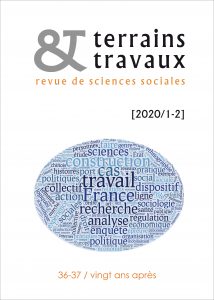Concurrencer l’école publique.
Entrepreneurs en éducation et formes alternatives d’enseignement
Appel à contributions pour dossier thématique
Date de clôture : 28 février 2022
Les expériences éducatives alternatives au système d’enseignement « classique » sont loin d’être inédites, comme le montre la vitalité des mouvements de l’éducation nouvelle entre le dernier quart du XIXe siècle et l’entre-deux-guerres, parties prenantes de la nébuleuse réformatrice de l’État. Leurs propositions pédagogiques fleurissent alors tant au sein de l’école publique que dans des écoles privées, à l’initiative de philanthropes, pédagogues, administrateurs et enseignant·es. Un mouvement analogue, alimentant des critiques visant l’enseignement scolaire public, ainsi que les appels à un renouvellement des apprentissages et des pratiques pédagogiques connaît depuis quelques années, en France, un certain essor, sous l’effet de la promotion de la liberté des familles et du « choix » parental, de l’aspiration à un traitement plus « personnalisé » des élèves et de l’accroissement de la concurrence entre établissements. En témoignent en France le succès des pédagogies dites «alternatives», l’attrait croissant qu’exercent les établissements privés, l’émergence d’une catégorie «d’entrepreneurs en éducation», et le renouveau de l’enseignement à domicile. L’aspect le plus remarquable de ces offres éducatives, très hétérogènes et animées par des visions du monde et des intérêts parfois contradictoires, réside dans le fait qu’elles se proposent de réformer l’école publique, non pas de l’intérieur, mais de l’extérieur, en entreprenant de développer à la lisière des établissements scolaires publics, ou loin d’eux, des projets jugés plus en phase avec les aspirations des élèves et des familles. Si ces idées réformatrices oscillent entre, d’un côté, la volonté de mieux s’ajuster aux attentes des publics du système d’enseignement traditionnel et, de l’autre, le désir d’en contourner les normes et les modes de sélection, elles tendent à remettre en cause, directement ou indirectement, la légitimité et la capacité de l’État à administrer l’éducation de ses citoyen·nes et enferment, en creux, une critique du «pacte social» que constitue l’institution scolaire dans nos sociétés. Bien que composite, cette offre apparaît moins sous-tendue par une ambition émancipatrice que par la volonté de doter les familles d’un «capital humain» et de faire l’éducation moins un enjeu de société qu’un investissement comme un autre.
Les propositions attendues pour ce dossier de terrains & travaux devront permettre de mieux comprendre les motivations des différents acteurs et actrices contribuant à la mise en place de pédagogies alternatives, de mieux connaître leur contenu ainsi que leurs effets sociaux. Ce dossier vise ainsi in fine à mieux appréhender, à travers des travaux empiriques, les caractéristiques de ces formes alternatives d’éducation, leurs usages par les apprenants, mais aussi, plus généralement, leurs effets sur le système scolaire public et sur les inégalités.
Les articles pourront s’inscrire dans l’un des trois axes présentés ci-dessous ou à leur croisement.
- I. Entrepreneurs en éducation et entreprises éducatives dans l’espace scolaire. Vers une privatisation de l’offre éducative ?
Dans un contexte d’individualisation des politiques éducatives et d’intériorisation de l’impératif scolaire, l’offre privée d’éducation semble s’être développée en adoptant des formes renouvelées. On peut y voir l’effet d’une «numérisation» de l’offre (écoles en ligne, plateformes de cours particuliers, applications de soutien scolaire), de l’émergence de certaines professions (le coaching scolaire), du développement du tiers-secteur (la philanthropie éducative, les think tanks en éducation) ou de modèles lucratifs d’entreprises (comme pour certaines écoles hors-contrat ou les start-up de «l’edtech»). L’intervention, à différents niveaux, des acteurs privés en éducation n’est pas nouvelle, comme en témoignent la régulation de l’enseignement professionnel par les branches professionnelles, l’influence des milieux patronaux sur les cursus, ou plus récemment la formation des élèves et des étudiant·es à l’entrepreneuriat. Néanmoins, l’intérêt spécifique de certains acteurs privés à l’égard de l’offre éducative, leurs caractéristiques et leurs modes d’action restent encore largement méconnus, notamment dans le contexte français. Ce premier axe visera donc à mieux caractériser le champ des «entrepreneurs de l’éducation» et à interroger la spécificité de cette offre éducative. Ces pratiques éducatives hors de l’école s’inscrivent, en effet, dans des dynamiques longues de privatisation et d’hybridation des rapports public-privé, qui remettent en cause tout autant la place de l’offre publique, sa légitimité que le principe de la régulation, par les pouvoirs publics, de l’offre scolaire. Aussi, les recherches explorant les processus de privatisation et de mise en marché de l’éducation seront-elles bienvenues : développement d’une offre éducative peu ou pas régulée par les autorités publiques, ouverture des services publics éducatifs à des financements privés, ou encore sous-traitance de services éducatifs à des opérateurs extérieurs.
Le profil et les trajectoires des promoteurs et acteurs de ces entreprises éducatives pourront, en premier lieu, être étudiés, en réservant une place à la manière dont ils s’appuient paradoxalement sur les pouvoirs publics (via des subventions, défiscalisation, autorisations, agréments, etc.) pour développer une offre concurrente à celle de l’enseignement public. La façon dont ces acteurs défendent, en second lieu, la légitimité de leurs conceptions éducatives et de leurs manières d’agir auprès d’interlocuteurs et de publics divers (patronaux, pouvoirs publics, Éducation nationale) pourra être questionnée. La question du financement des entreprises éducatives, des pratiques et des modèles économiques qui les sous-tendent, méritera aussi examen. Car si certaines bénéficient du soutien des pouvoirs publics ou escomptent leur aide, d’autres parient plutôt sur leur capacité à développer une offre marchande autonome, et entendent attirer des investisseurs intéressés par les perspectives de profit qu’offre un marché semble-t-il prometteur. En troisième lieu, le travail concrètement engagé dans ces formes alternatives d’enseignement, et les types de pratiques éducatives mises en place, retiendront l’attention, qu’il s’agisse de pratiques renouant avec des formes scolaires traditionnelles ou déjà éprouvées (préceptorat, enseignements d’inspiration plus libertaire) ou de celles insistant plutôt sur leur caractère innovant (apprentissage en ligne, e-learning) afin d’attirer des familles séduites par une prise en charge plus individualisée de leurs enfants. Les contributions seront invitées à analyser la manière dont ces pratiques hétérogènes sont régulées par les pouvoirs publics ou au contraire échappent à leur contrôle.
- II. Un autre rapport à l’éducation ? Choix éducatifs et apprentissages « alternatifs »
Cet axe invite à interroger les stratégies et les choix faits par les familles, et les apprentissages chez les élèves, en vue de mieux saisir les effets du recours à des formes alternatives d’enseignement sur le système public d’éducation. Les contributions pourront ainsi aborder les déterminants sociaux de la « demande » d’éducation privée alternative et comment les familles, sur la base de relations affinitaires, ou de positionnements socio-économiques ou culturels, en viennent à recourir à ces nouvelles manières d’éduquer et d’instruire. Au sein d’une offre très hétérogène, il apparaît important de regarder finement les appartenances sociales des familles et leurs rapports à l’école, et d’examiner comment elles s’investissent scolairement et pédagogiquement « à côté de » l’école publique, dans différents segments de l’offre privée. S’agit-il plutôt de familles appartenant à des groupes socialement dominés qui ne trouveraient pas, dans le système existant, une offre adaptée à leurs besoins et à leurs aspirations ? Si c’est le cas, doit-on y voir l’effet d’un amoindrissement de la croyance des milieux populaires dans les capacités émancipatrices de l’école ? Est-on plutôt face à des familles issues des classes moyennes et supérieures souhaitant échapper aux écueils d’une école massifiée, voire de familles fortement dotées préférant scolariser leurs enfants dans des établissements jugés plus en phase avec les exigences d’un monde globalisé ? Entre souci d’ajustement aux attentes scolaires (le recours au soutien scolaire, au coaching, etc.) et défection du système scolaire (le choix du hors contrat, de l’école à domicile) s’expriment différents usages de ces entreprises éducatives et différents rapports à l’école. On pourra se demander en quoi l’offre privée « alternative » témoigne de transformations des rapports des familles à l’école (voire de prises de distance avec le système scolaire), notamment liées aux transformations du système éducatif et aux attentes générées par l’allongement des études. Les contributions pourront venir alimenter les travaux sur les rapports à l’école et à l’État des familles et des élèves, et sur les effets de la crise sanitaire du Covid-19. On pourra également questionner le renouvellement de la place des parents à l’œuvre dans l’offre privée éducative, se demander comment les familles contribuent éventuellement à définir les contours de cette offre : dans l’enseignement à domicile, dans certaines écoles privées réservant une place spécifique aux parents, ou dans certaines aventures entrepreneuriales mettant en avant l’« expérience parentale » des créateurs d’entreprise. Les profits que les bénéficiaires retirent de ces expériences singulières (et d’une socialisation aux marges ou extérieure au système scolaire) mériteront également examen. Les parcours des élèves ayant bénéficié d’une éducation hors contrat, à domicile ou de formes de scolarisation en marge de l’école, restent en effet largement méconnus. Les effets socialisateurs durables de ces expériences et leurs incidences sur les trajectoires individuelles – que les élèves demeurent aux marges de l’école publique ou la réintègrent – pourront être explorés.
- III. Les effets des entreprises éducatives sur le système public d’éducation
Enfin, un troisième axe invite à discuter les effets des entreprises éducatives et du recours par les familles à une offre privée «alternative», sur le système public d’éducation, et in fine sur les inégalités scolaires. Le fait que le centre de gravité de la régulation de l’offre d’éducation se déplace des autorités publiques vers les familles, érigées tacitement, par les prescripteurs de ces services éducatifs, en arbitres de la concurrence entre les différents fournisseurs de biens éducatifs (publics, privés à but non lucratif, privés à but lucratif) méritera attention. L’ampleur que revêt ce phénomène multiforme de remise en cause du système public d’enseignement, en France et dans d’autres pays, pourra être questionnée. L’impact de ces transformations sur les inégalités scolaires pourra aussi être interrogé. Les contributions pourront analyser la façon dont les institutions scolaires publiques composent avec le développement d’un secteur éducatif privé à leurs marges, en tentant d’en enrayer la croissance, en encourageant son développement ou en empruntant certains de ses registres d’action. Les travaux (s’appuyant sur des données statistiques ou des analyses comparatives) qui permettent, dans cette perspective, d’appréhender la manière dont cette recomposition de l’offre éducative affecte les trajectoires scolaires individuelles et l’évolution de la stratification sociale, seront bienvenus. L’importance éventuelle que revêt, aux yeux de ces acteurs réformateurs, l’objectif de réduction des inégalités scolaires, ou au contraire l’impensé qu’il constitue pour ces derniers, constitueront aussi des pistes de réflexion.
Les articles, de 50 000 signes maximum (espaces, notes et bibliographie compris), accompagnés d’un résumé de 150 mots et de 5 mots-clés en français et en anglais, devront parvenir sous forme électronique (format Word, cf. indications ci-dessous pour la mise en forme des textes) aux coordinateur·trice·s du numéro avant le 28 février 2022 aux adresses suivantes :
- Caroline Bertron : carolinehs.bertron[at]gmail.com
- Samuel Bouron : samuel.bouron[at]dauphine.psl.eu
- Marie Carcassonne : marie.carcassonne[at]dauphine.psl.eu
- Sabine Rozier : sabine.rozier[at]dauphine.psl.eu
- Elise Tenret : elise.tenret[at]dauphine.psl.eu
- Marie Trespeuch : marie.trespeuch[at]sorbonne-universite.fr
Les consignes relatives à la mise en forme des manuscrits sont consultables sur le site de la revue : http://tt.hypotheses.org/consignes-aux-contributeurs/mise-en-forme
terrains & travaux accueille par ailleurs des articles hors dossier thématique (50 000 signes maximum), qui doivent être envoyés à :
- Vincent-Arnaud Chappe : vincent-arnaud.chappe[at]ehess.fr
- Élise Palomares : elise.palomares[at]univ-rouen.fr
- Milena Jakšić : milenajaksic[at]gmail.com
Pour plus de détails, merci de consulter le site de la revue : http://tt.hypotheses.org