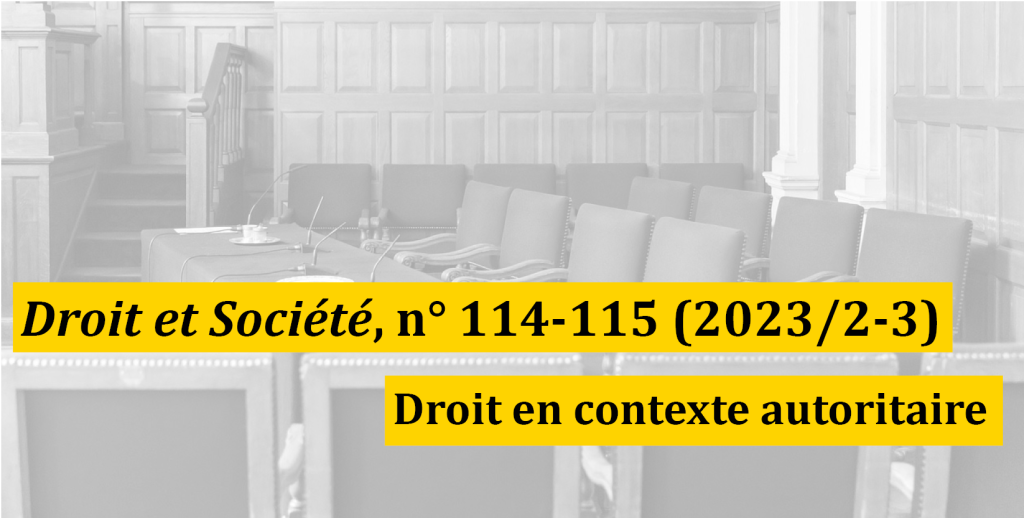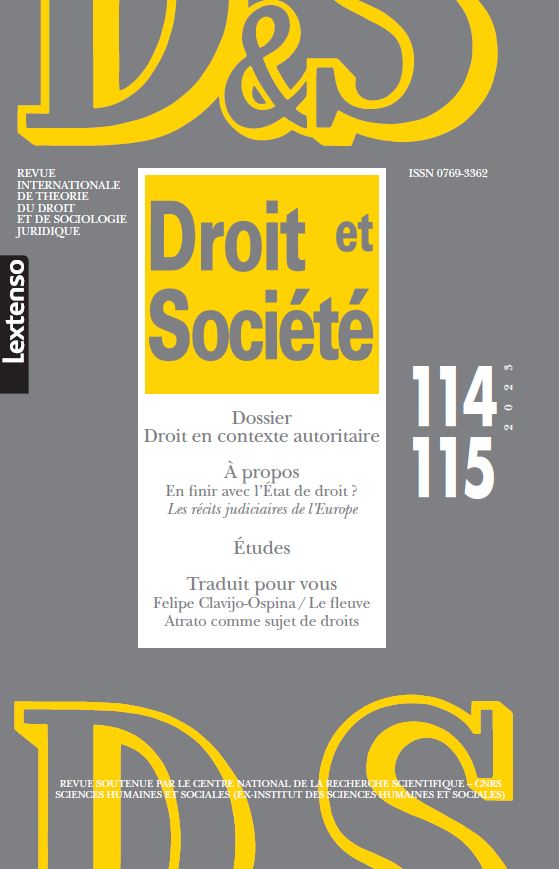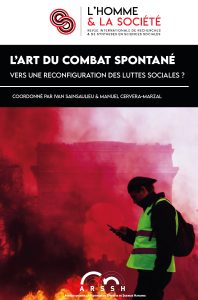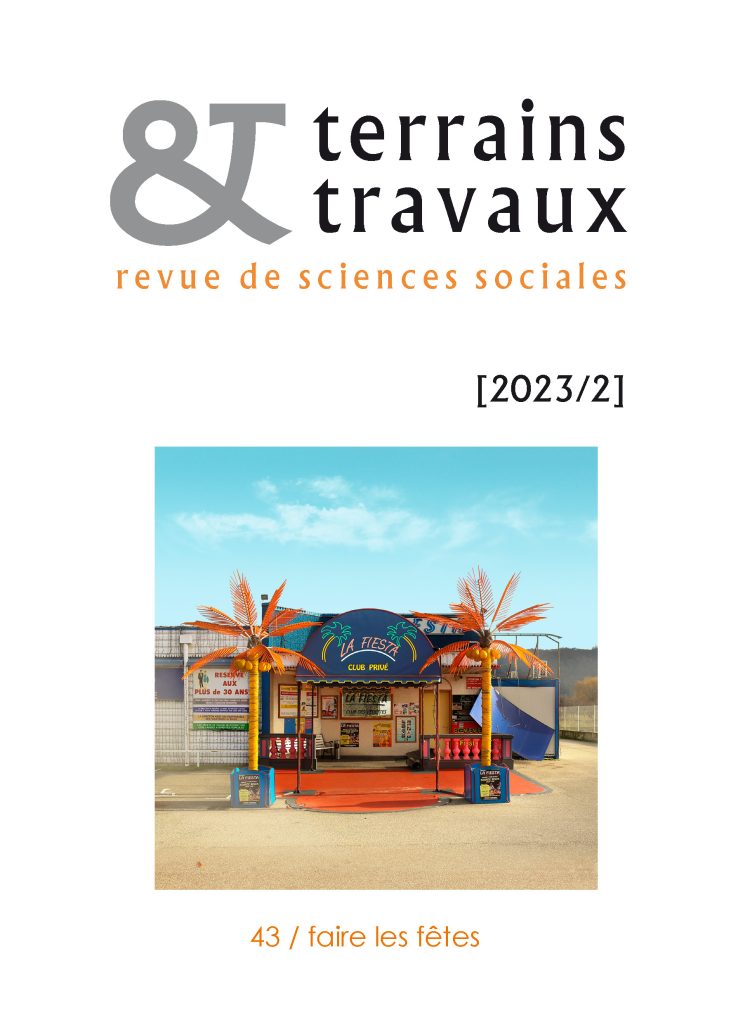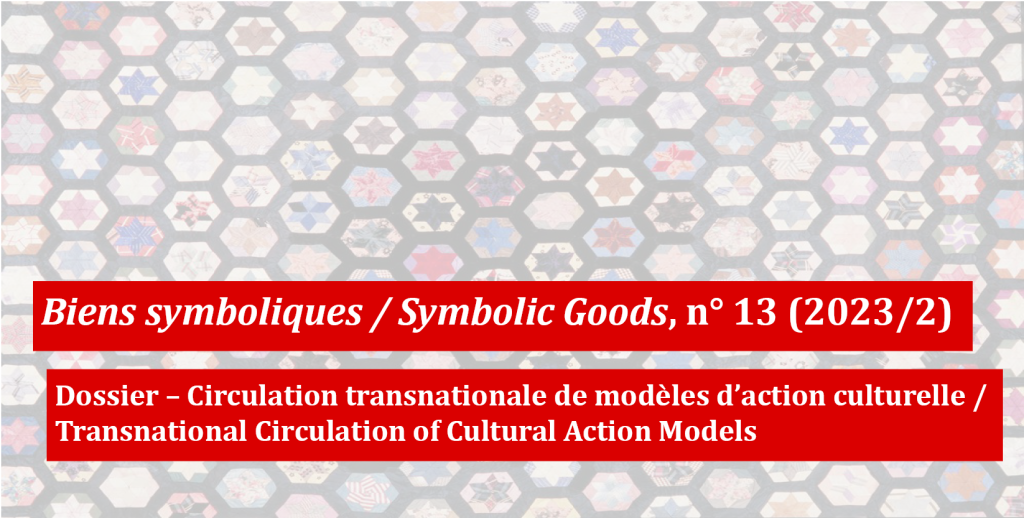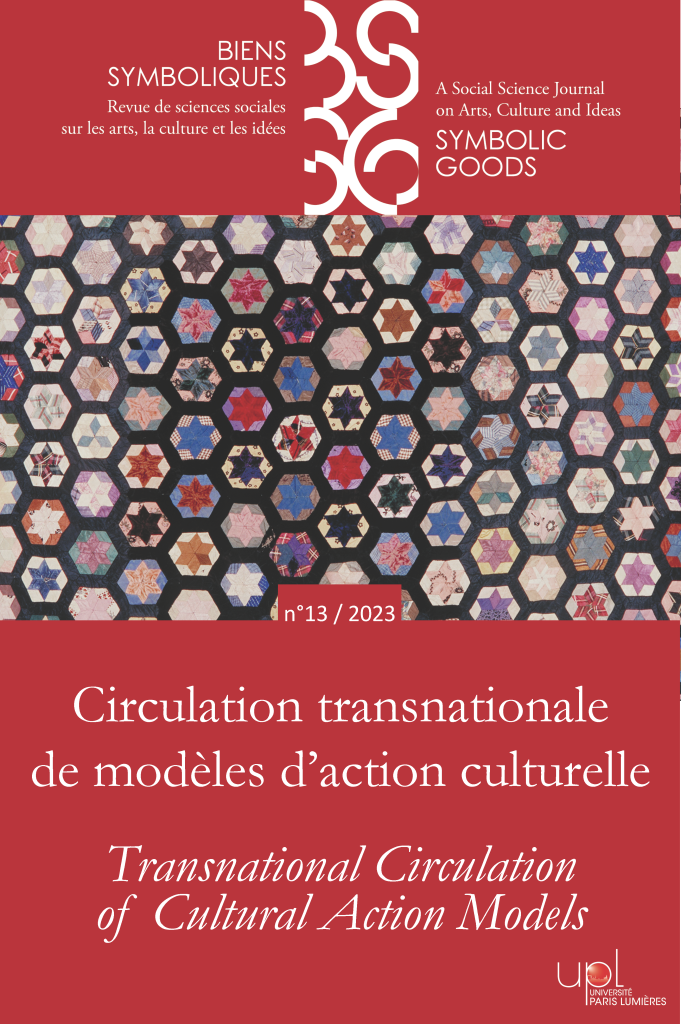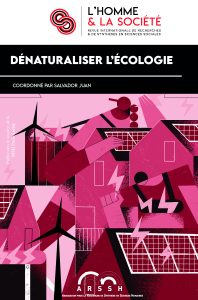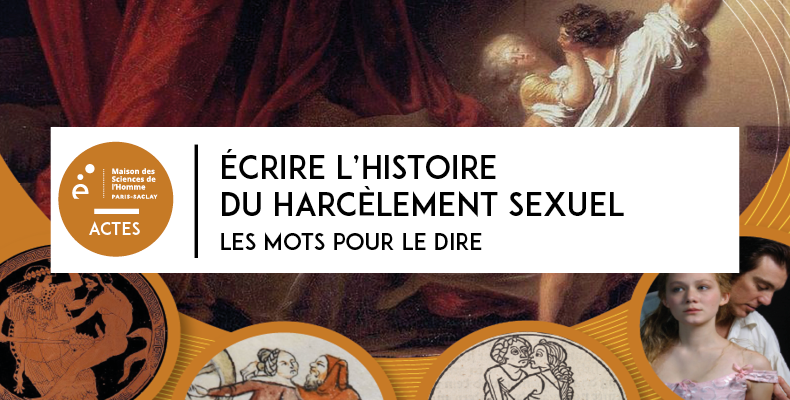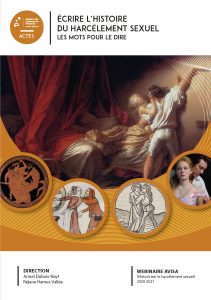Appel à contributions pour terrains & travaux : Les ancrages sociaux de la grève
Appel à contributions pour terrains & travaux : "Les ancrages sociaux de la grève"
INFORMATIONS
La revue terrains & travaux, accompagnée par la MSH Paris-Saclay, lance un appel à contributions pour son dossier thématique : « Les ancrages sociaux de la grève ».
Date de clôture de l’appel : 31 janvier 2025
Télécharger ici l’appel au format PDF
Présentation de l'appel
L’actualité sociale de ces dernières années a été marquée par de nombreux conflits sociaux de grande ampleur. Ces luttes se sont déployées aussi bien à l’échelle interprofessionnelle (grèves contre la Loi Travail en 2016 et contre la réforme des retraites en 2019 et 2023) qu’à celle des entreprises (grève des cheminot·e·s en 2018, grèves de postier·e·s, grèves pour les salaires face à l’inflation). Elles ne sont pas cantonnées à la France puisqu’on les retrouve dans des pays aussi variés que les États-Unis, le Bangladesh ou l’Argentine, où le droit du travail et/ou l’organisation de la défense des salarié·e·s connaissent ou ont connu des politiques intenses de répression ou de domestication. À l’image du dernier mouvement de protestation contre la réforme des retraites, les grèves suscitent aussi de grands élans de solidarité, réactivant l’idée de « grèves par procuration ». De plus, ces mobilisations se sont parfois déployées en dehors des « bastions traditionnels » du mouvement ouvrier, à l’image des grèves des femmes de chambre, des ouvrier·e·s du secteur logistique, des livreurs·euses « ubérisé·e·s », des travailleurs·euses sans-papiers de la restauration ou de la construction. Enfin, la mobilisation de l’imaginaire de la grève autour d’objets hétérogènes et de plus en plus éloignés du champ des relations professionnelles instituées, par les mouvements féministes (grève des femmes contre les inégalités de salaires ou le travail domestique) et écologiques (grèves contre l’inaction climatique des gouvernements), témoigne a minima d’une certaine revitalisation politique et symbolique de cette modalité d’action. Ces réappropriations questionnent d’autant plus ce qui « fait grève » que, dans le même temps, certains syndicats ont au contraire tendance à recourir à des formes d’euphémisation ou de périphrase (« mettre le pays à l’arrêt », « tout bloquer »…).
Si elle n’a pas disparu, la grève apparaît cependant moins au cœur du répertoire d’action syndical qu’elle ne l’était auparavant. Les possibilités de recours à la grève et les modalités de ses usages se reconfigurent tout d’abord sous l’effet de l’institutionnalisation croissante du syndicalisme et de l’évolution du profil militant de ses représentants. Dans le même temps, elles se transforment à l’épreuve des nouvelles contraintes économiques, légales et idéologiques qui caractérisent le capitalisme contemporain. La diffusion du crédit à la consommation, la diminution du « reste à vivre » et plus récemment la poussée inflationniste, reposent par exemple la question du coût matériel et financier de la pratique gréviste pour un salariat précarisé. Dans le même temps, les restructurations du système productif, l’éclatement des collectifs de travail, l’affaiblissement des organisations syndicales et le durcissement des dispositifs légaux (restriction du droit de grève dans le privé, « service minimum » dans le public) ont contribué à la diminution de l’intensité des grèves dans les économies occidentales. En France, par exemple, les grèves sont tendanciellement moins massives, plus souvent défensives et concentrées sur quelques secteurs (la fonction publique, les anciennes entreprises publiques de transport, quelques grandes entreprises de l’industrie). Si le grand conflit social contre la réforme des retraites en 2023 a témoigné du maintien d’une réelle capacité de mobilisation des organisations syndicales, il a cependant illustré leurs difficultés à faire de la grève la modalité centrale de la protestation. À cette occasion, des modalités d’action traditionnelles, comme les piquets de grève ou les assemblées générales, ont aussi semblé montrer une forme (temporaire ?) d’épuisement.
Cette double dynamique est donc paradoxale. Elle nous invite à étudier conjointement la continuité du répertoire d’action syndicale et le renouvellement des possibilités de la grève et de ses pratiques. Dans cette perspective, ce dossier se propose d’étudier les modalités d’ancrage social de la pratique de la grève. Son objectif est d’analyser ensemble celles et ceux qui font grève dans un contexte où ils et elles sont de plus en plus minoritaires à le faire, les soutiens que les grèves coalisent comme les contre-mobilisations qu’elles peuvent susciter, avec l’ambition de contribuer à mieux rendre compte des obstacles à la grève, de ses conditions de possibilité et des modalités renouvelées d’appropriation de la pratique gréviste. Pour cela, trois angles seront privilégiés.
1. Les conditions d’(im)possibilité des grèves
Ce dossier a d’abord pour ambition d’explorer les contextes sociaux de la grève.
Les données statistiques relatives aux grèves mettent en évidence leur distribution très inégale dans le monde salarial. Celle-ci est à mettre évidemment en perspective avec la variété des modalités de la présence syndicale, des configurations de rapports salariaux et des modes de structuration des collectifs de travail, plus souvent disloqués que par le passé (diversification des statuts d’emploi, dispersion des lieux de travail, développement des horaires atypiques et du télétravail, etc.). Elle nécessite néanmoins de mieux documenter les stratégies patronales d’évitement des grèves ou de contournement des tentatives de mobilisation syndicale, allant parfois jusqu’à susciter des contre-mobilisations. Dans une perspective complémentaire, il est nécessaire de mieux analyser les frontières sociales et politiques de la pratique de la grève, en lien avec la transformation de la morphologie du salariat et de ses modes de politisation. Que nous dit en effet la pratique socialement située de la grève sur l’évolution et la diversité du rapport des salarié·es à ce mode emblématique de mobilisation professionnelle ? Dans un contexte marqué par la tertiarisation de l’économie, on pourra tout autant se demander dans quelle mesure et de quelle manière les organisations syndicales adaptent en conséquence leurs façons de faire usage de la grève, que les salarié·es soient empêché·es de cesser le travail (par exemple dans le secteur de la santé), qu’ils et elles se l’interdisent (notamment pour ne pas pénaliser des usagers), ou que la grève leur apparaisse trop coûteuse, voire inutile. Ce dossier invite ce faisant à penser ensemble les obstacles à la diffusion de la pratique gréviste et la diversité de ses modalités d’appropriation possibles, notamment dans des contextes où elle est rare. Il propose également de mettre en perspective le déclin de l’intensité des grèves, observé dans le contexte occidental, avec le redéploiement des grèves dans les Suds, que les nouvelles formes de division internationale du travail ont rendu possible.
2. Faire grève
Ce dossier entend ensuite explorer les pratiques contemporaines de la grève.
La dislocation des grandes concentrations ouvrières, qui facilitaient le recours à la grève et la rendaient visible par son caractère massif, n’a pas seulement remis en cause l’importance stratégique généralement attribuée aux grèves dans la conflictualité salariale. Les transformations du mode de production capitaliste ont aussi contribué à l’atomisation des conflits du travail et à modifier les modalités possibles de leur organisation et de leur déroulement. Dans le même temps, des débrayages ont lieu dans les nouveaux « goulots d’étranglement » du capitalisme que sont les entrepôts logistiques, et des mouvements collectifs de déconnexion volontaire s’organisent parmi les travailleur·euses ubérisé·es. Comment se réinventent donc les stratégies de la grève et les modalités du répertoire d’action gréviste en dehors des « bastions traditionnels » ? Assiste-t-on à l’émergence de nouveaux « foyers » grévistes, porteurs d’un renouvellement des pratiques ? À l’image des grèves de l’hôtel Ibis ou de l’usine Verbaudet, certains conflits récents interrogent également l’articulation des identités de classe, de genre et de race. Plus largement, comment se différencient les manières de faire grève selon que l’on est cadre, ouvrier·e métallurgiste, cheminot·e, femme de chambre ou livreur·euse ? Quelles acceptions la pratique de la grève prend-t-elle dans un contexte d’institutionnalisation du syndicalisme et d’autonomisation par rapport au champ politique ? Pour en rendre compte, l’analyse de son ancrage dans d’autres contextes nationaux que la France, héritiers de modèles syndicaux différents ou en leur absence totale, apparaît particulièrement bienvenue. Des mises en perspective historiques des pratiques grévistes pourraient également se révéler éclairantes pour mieux comprendre les appropriations différenciées de la grève qu’on observe aujourd’hui.
3. La grève : un prolongement des solidarités extérieures aux entreprises ?
En sciences sociales, la pratique gréviste a le plus souvent été abordée comme une relation triangulaire impliquant les salarié·es, leurs organisations syndicales et les directions d’entreprise, comme si les relations professionnelles étaient un champ autonome et entièrement désencastré des autres rapports sociaux. Les grèves et le soutien dont elles peuvent bénéficier sont pourtant fortement déterminés par leur inscription dans des configurations sociales qui débordent le lieu de travail : c’est pourquoi il est nécessaire de les aborder de manière décloisonnée. Il s’agira donc ici de se pencher sur les différents soutiens extérieurs à la grève, en interrogeant les pratiques et le sens de la solidarité ouvrière, mais aussi des solidarités familiales, communautaires ou organisationnelles. En mobilisant les apports de la sociologie urbaine et de la géographie sociale, il serait intéressant d’éclairer les ancrages territoriaux de la pratique gréviste. Enfin, si ces solidarités diverses peuvent contribuer à rendre la grève possible ou lui permettre de durer, elles peuvent également conduire à certaines pratiques délégataires de l’arrêt de travail. Ainsi, les soutiens extérieurs ont parfois permis le succès de certaines luttes selon une logique de « grève par procuration », mais ils ont aussi pu marquer une délimitation entre les salarié·es encore en capacité de faire grève et ceux qui ne pourraient que les soutenir, et conduire alors à isoler les « bastions » des grèves. D’ailleurs, certains blocages récents (d’incinérateurs ou de dépôts d’éboueurs) questionnent aussi la manière dont l’action de ces soutiens extérieurs s’articule à celle des salariés mobilisés : vient-elle en renfort à la grève des salariés ou tend-elle à s’y substituer ? Que nous disent ces différentes formes de « grève par procuration » sur le conflit social aujourd’hui ? De quelle manière la solidarité avec les grévistes refaçonne-t-elle la division du travail militant ? Contribue-t-elle à l’élargissement des pratiques canoniques de la grève, ou manifeste-t-elle au contraire une autre forme de son épuisement ?
Ce dossier réunira des articles empiriques originaux de sciences sociales (sociologie, science politique, histoire, géographie, sciences de gestion, économie, etc.). Les études de cas internationaux seront aussi les bienvenues.
[Illustration : Miguel Ausejo sur Unsplash]
Consignes de soumission
- Les articles, de 50 000 signes maximum (espaces, notes et bibliographie compris), doivent être accompagnés de 5 mots-clés et d’un résumé de 150 mots (en français et en anglais).
Ils devront parvenir aux coordinateur·rices du numéro avant le 31 janvier 2025 aux adresses suivantes :
- Pauline Grimaud : pauline.grimaud@sciencespo.fr
- Gabriel Rosenman :gabriel.rosenman@gmail.com
- Baptiste Giraud : baptiste.giraud@univ-amu.fr
- Maxime Quijoux : maxime.quijoux@lecnam.net
Les consignes relatives à la mise en forme des manuscrits sont consultables sur le site de la revue : http://tt.hypotheses.org/consignes-aux-contributeurs/mise-en-forme
terrains & travaux accueille par ailleurs des articles varia, hors dossier thématique (50 000 signes maximum), qui doivent être envoyés à :
- Jean-Noël Jouzel : jeannoel.jouzel@sciencespo.fr
- Élise Palomares : elise.palomares@univ-rouen.fr
- Maxime Quijoux : maxime.quijoux@lecnam.net
Appel à contributions pour terrains & travaux : Les ancrages sociaux de la grève Lire la suite »